| Dernière mise à jour : mardi 24 avril 2001 17:42:45 Dr Jean-Michel Thurin |
| 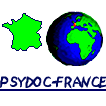
|
Figure 1 : Comparaison du coût de la
dépression avec d’autres pathologies (25)
Les défaillances de sa
prise en charge
Force est de constater que la prise en charge actuelle de la
dépression est sous-optimale. La dépression est encore trop
rarement diagnostiquée et correctement traitée.
Pourtant, il existe un arsenal thérapeutique efficace
permettant de traiter la dépression, et ainsi d'améliorer non
seulement la qualité de vie des dépressifs, mais aussi celle de
leur entourage : les antidépresseurs.
Face à l'impact de la dépression pour le
patient et pour la société, il existe pourtant des
solutions : le traitement thérapeutique. Ce dernier peut prendre
plusieurs forme, à savoir : la psychothérapie, les
électrochocs (ECT) et, bien sûr, le traitement
médicamenteux par antidépresseur. Le but du traitement est
d’amener le patient à un état stable, asymptotique, avec
une restauration des fonctions psychosociales, et d’établir un
état de bien-être à long terme (4).
Le traitement par antidépresseur est efficace de par
son action thérapeutique spécifique sur les troubles de l'humeur.
Des essais cliniques ont démontré l'efficacité de ces
traitements, à l’aide d’échelles spécifiques
telles que l’Hamilton Depression Rating Scale, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale
ou Clinical Global Impression, indiquant un taux de réponse de
l’ordre de 70 % (11). Les antidépresseurs permettent une
levée des symptômes dépressifs[1]
(3). Leur administration requiert certaines conditions, notamment la
présence d’un épisode dépressif confirmé, la
possibilité d’obtenir la coopération du malade, le suivi
régulier du patient pour évaluer le bénéfice
thérapeutique.
L’autorisation de mise sur le marché des
antidépresseurs mentionne le traitement de la dépression en
première indication, du fait de leur action thérapeutique
spécifique sur les troubles de l’humeur. Cependant, les
antidépresseurs sont également efficaces dans la
prévention des attaques de panique, le traitement des troubles
obsessionnels compulsifs et dans le traitement de certaines algies rebelles
(3).
Actuellement, il existe plusieurs catégories
d’antidépresseurs : les dérivés imipraminiques
(ou tricycliques), les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO,
réversibles ou non), les inhibiteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine (ISRS), les inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) et les
antidépresseurs de profils chimiques différents (cf. Annexe 2).
Ils sont tous indiqués pour le traitement des
épisodes dépressifs majeurs avec un délai d'action de
l'ordre de quatre à six semaines. Le délai d’action
spécifique sur l’humeur se manifeste après dix à
vingt jours à posologie suffisante, même si une amélioration
symptomatique sur le ralentissement idéomoteur, l’insomnie ou
l’anxiété est observée précocement. Il est
recommandé de ne pas interrompre le traitement pour inefficacité
avant trois à six semaines (3).
La phase de traitement initial se différencie selon
les antidépresseurs. Ainsi, les dérivés imipraminiques
sont administrés de façon progressive sur plusieurs jours, afin
d’obtenir une dose quotidienne comprise entre 75 et 150 mg.
L’administration des IMAO se fait de façon encore plus progressive
pour atteindre des doses de 300 à 600 mg par jour. Par contre les ISRS
se prescrivent d’emblée ou presque aux doses
préconisées, différentes selon la molécule (3).
La poursuite du traitement est de l’ordre de six mois
après la disparition des symptômes de dépression. Il est
nécessaire de diminuer très progressivement les doses afin de
réduire les risques de sevrage, et ce quel que soit
l’antidépresseur prescrit. Il existe des traitements de
consolidation dont le but est de réduire le risque de rechute, autrement
dit la réapparition des manifestations de l’épisode
dépressif en cours de traitement, et des traitements de maintenance
prévenant la récidive chez les patients à risque pour une
durée comprise entre quatre et cinq ans (3).
Il existe aujourd’hui un débat concernant le
choix de l’antidépresseur en première ligne de traitement.
En effet, la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine (ISRS) présente l’avantage, à même
efficacité que les dérivés imipraminiques (70 %), de
posséder de moindres effets indésirables (absence d’effets
secondaires anticholinergiques et de toxicité cardiaque), engendrant
ainsi une meilleure tolérance et facilitant leur administration en
ambulatoire, au prix d’un coût d’acquisition plus
élevé.
La méta-analyse menée par Anderson (4),
à partir de 62 essais randomisés, souligne une meilleure
observance, pour les ISRS par rapport aux dérivés imipraminiques,
provenant du plus faible taux d’interruption : 10 % de moins
sur la totalité des interruptions, et 25 % de moins si l’on
considère uniquement les effets indésirables.
Dans le contexte actuel de maîtrise des
dépenses de santé, il va sans dire que cela favorise la
multiplication des études de rendement entre les ISRS et les
imipraminiques (18) (20) (28) (34) (40) (41).
Ces études s'appuient toutes sur des essais cliniques
et modélisent ainsi les résultats.
Or ces essais s'appuient sur des hypothèses
très restrictives, en termes de durée de traitement (quatre
à six semaines) plus courte que la durée préconisée
par les RMO, en termes de sélection des patients (sex ratio de 1, alors que les femmes sont 4 fois plus
nombreuses que les hommes), qui ne se retrouvent pas en pratique courante,
pouvant ainsi induire des biais et ne pas refléter la situation
réelle. Il apparaît que les résultats sont
extrêmement liés à la méthodologie utilisée.
De plus, il est également nécessaire de rappeler que la prise en
compte des coûts indirects est nécessaire si l'on veut obtenir des
données significatives.
La plupart de ces études démontrent le
coût-efficacité des ISRS, et cela principalement du fait du moindre
recours aux soins hospitaliers (20). Par contre, Simon (41) ne dégage
pas de différence de coût à six mois entre les deux types
de traitement. Il se dégage donc de ces études un avantage pour
les ISRS sur les imipraminiques. Leur coût d’acquisition étant
compensé par un moindre recours à l’utilisation des
ressources médicales, notamment l’hospitalisation et une meilleure
observance. Toutefois, les RMO actuelles ne préconisent pas un
antidépresseur en particulier dans le traitement en première
ligne de la dépression, ce choix est de la responsabilité du
prescripteur.
Une
maladie sous-diagnostiquée
Le sous-diagnostic de la dépression est reconnu par
de nombreux auteurs (15) (26) (13) (24) (31) (17), mais très peu
l’ont mesuré. Henry (19) à partir de la littérature,
avance que seulement 30 % des dépressifs sont correctement
diagnostiqués. Il s’agit d’un constat terrible. Toutefois,
il convient de préciser qu’Henry ne spécifie pas le type de
dépression retenue, qu’il s’appuie sur seulement deux
études mesurant le taux de diagnostic des dépressifs (34bis) (21)
et qu’il en déduit alors un taux moyen du sous-diagnostic de la
dépression.
En dépit des critiques formulées quant
à la méthodologie utilisée par Henry, le sous-diagnostic
de la dépression n’en demeure pas moins, dont les arguments
explicatifs s’articulent autour de trois axes : à savoir le
patient, le médecin, et les systèmes de soins et
d’assurance maladie.
Les patients ont effectivement un rôle actif, et ce,
de par la volonté de nier l’existence d’une maladie pas
toujours reconnue en tant que telle. Ce déni pouvant se traduire par un
refus du diagnostic (15). L'étude DEPRES (29) signale que 31 % des
dépressifs majeurs ne consultent pas leur médecin pour leur dépression,
et la plupart n’y songent même pas.
Les médecins eux aussi ont une part non
négligeable dans l'explication de ce sous-diagnostic. Il persiste encore
parmi certains d’entre eux le refus de reconnaître la
dépression comme une pathologie à part entière. De plus,
les médecins, et plus particulièrement les
généralistes, souffrent d’un déficit des
connaissances permettant l’établissement d’un diagnostic de
dépression, surtout lorsque cette dernière est cachée par
une comorbidité importante.
A toutes ces raisons, s’ajoute le système de soins
qui impose des contraintes aux médecins, sur la durée des
consultations par exemple.
La durée nécessaire d’une consultation
pour un dépressif se traduit par un temps de consultation plus
élevé. D’ailleurs, Kind (23) souligne qu’une
consultation pour dépression coûte 17 livres sterling, contre 4,3
à 7,5 pour un autre type de consultation. D'autres arguments sont
mentionnés, mais ils concernent plutôt des systèmes de
santé de type HMO existant aux Etats-Unis, où l'accès aux
soins et aux traitements peut être limité, selon le type de
paiement (au forfait ou à l’acte).
En résumé, le sous-diagnostic de la
dépression s'explique majoritairement par une interaction de
comportements et d’attitudes entre les médecins, les patients et
le système de soins, mais surtout par un manque de connaissances.
Des malades sous-traités
Non seulement, la dépression est
sous-diagnostiquée, mais en plus elle est sous-traitée. Parmi les
dépressifs correctement diagnostiqués, seulement un tiers
reçoit une prescription médicamenteuse (Henry, 19).
L’étude DEPRES (Lépine, 29) apporte des résultats
similaires. Cependant, il convient de souligner la corrélation positive
entre sévérité de la dépression et prescription médicamenteuse.
Ainsi, en France, la moitié des dépressions majeures ont une
prescription médicamenteuse.
Tableau 1 : Prescription
médicamenteuse par pays et sévérité
dépression (Source : 29)
|
% de prescription médicamenteuse |
||||
|
Pays |
Toute dépression |
Dépression majeure |
Dépression mineure |
Symptômes dépressifs |
|
Allemagne |
22,6 |
34,6 |
26,1 |
13,3 |
|
Belgique |
38,8 |
49,9 |
36,7 |
29,6 |
|
Espagne |
26,9 |
34,5 |
18,9 |
22,7 |
|
France |
38,7 |
51,4 |
29,2 |
30,0 |
|
Grande-Bretagne |
25,4 |
34,6 |
22,8 |
17,0 |
|
Pays-Bas |
37,9 |
50,8 |
38,1 |
24,1 |
|
Total |
30,7 |
41,4 |
27,7 |
22,5 |
En tenant compte des données d'observance et de taux
de réponse issus de la littérature[2],
il en résulte que seulement 5 % des dépressifs
reçoivent une prise en charge médicale correcte pour leur
dépression (Henry, 19). Ce chiffre est alarmant.
[1] Tristesse, inhibition psychomotrice, désintérêt, troubles du sommeil, anxiété, idées de mort, de culpabilité, plaintes somatiques, amaigrissement, asthénie.
[2] Weissman, 1974 ; Gerner, 1980
| Dernière mise à jour : mardi 24 avril 2001 17:42:45 Dr Jean-Michel Thurin |
| 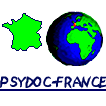
|