| Dernière mise à jour : jeudi 22 mars 2001 18:10:18 Dr Jean-Michel Thurin |
| 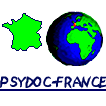
|
REFLEXION SUR LEURS TRAJECTOIRES EN FRANCE
Rapport du Groupe d’experts, coordonné et présidé par :
Pr Philippe-Jean PARQUET, psychiatre
Ont participé, en tant qu’experts et cliniciens :
Dr Laurent CHEVALLIER, médecin généraliste
Dr Henry CUCHE, psychiatre
Pr Guy DARCOURT, psychiatre
Pr Maurice FERRERI, psychiatre
Pr Paul FRIMAT, médecin du travail
Pr Rebecca FUHRER, épidémiologiste
Dr Patrick de LA SELLE, médecin généraliste
Pr Robert LAUNOIS, économiste de santé
Dr Marie-France MOLES, psychiatre
Pr Jean-Pierre OLIE, psychiatre
Dr Nathalie REGENSBERG, médecin généraliste
- La coordination de l’ensemble du travail a été assurée par le docteur Christiane Mirabaud.
- Le concours de M. Jean-Luc ANDREI, journaliste a été sollicité
- La recherche bibliographique et la rédaction du rapport ont été assurées par les docteurs Jacqueline Augendre, Jordi Molto-Santonja
et Martin Reca, psychiatres.
- L’ensemble du projet a été réalisé sur une période de 18 mois ; son avancement a nécessité, en dehors de la charge individuelle
de travail de conception, organisation et rédaction, une ou deux réunions par mois de tout ou partie des acteurs concernés.
- Les experts n’ont perçu ni rémunération ni contrepartie d’aucune sorte pour leur contribution à ce travail.
- La réalisation de ce travail a été rendue possible par la contribution financière des laboratoires Lundbeck, SmithKline Beecham et
Servier.
AVERTISSEMENT AUX LECTEURS
Le présent rapport se compose de différents chapitres qui se suivent selon une logique d'itinéraires des déprimés : depuis la démarche qui
amène à consulter jusqu'aux aspects préventifs. Pour une meilleure compréhension de ces trajectoires, il est recommandé, lors de la lecture,
de respecter le cheminement proposé. Il est cependant possible de lire chaque chapitre séparément. En effet, certains thèmes sont traités
dans plusieurs chapitres différents, ce qui permet une approche transversale du texte. Des renvois facilitent ce repérage.
INTRODUCTION
Depuis quelques années, la sémiologie psychiatrique connaît une remise en cause des conceptions classiques autour desquelles
s'étaient construits les modèles opératoires permettant de délimiter les contours de la discipline. Les progrès des différentes sciences
qui nourrissent le corpus psychiatrique (biologie, psychopharmacologie, épidémiologie) ainsi que leurs orientations épistémologiques
divergentes ont eu raison des derniers remparts consensuels.
Cela a été le point de départ d'une déconstruction des théories, en particulier dans le domaine des troubles thymiques, où les logiques
contradictoires de la dépression ont provoqué un profond questionnement sur la nature même de la souffrance humaine. Cette dilution
de la dépression dans la théorie a été reprise et amplifiée par les médias. On a alors vu apparaître la figure de “ l'expert profane ”
proposant des alternatives en dehors du cadre médical, avec, comme corollaire, un débat social autour de la pertinence des prises en
charge “ officielles ” des troubles de l'humeur.
Dans ce contexte de mouvance conceptuelle, le symptôme psychiatrique risque de perdre sa spécificité. Ainsi, pour ne citer que deux
exemples, la moindre tension psychologique est vite qualifiée d'angoisse et les difficultés existentielles de dépression.
Devant ce phénomène, que certains qualifient d'“ inflation diagnostique ”, il convient d'aller aux sources du problème, qui n'est autre que la
définition de l'objet d'étude de la psychiatrie.
Affirmer que la psychiatrie a pour objet (objectif...) le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies mentales peut paraître une
lapalissade, mais, au moins, cette proposition a le mérite d'identifier la question centrale.
La psychiatrie utilise-t-elle les mêmes critères que la médecine pour définir la maladie ?
L'opposition santé (normal)/maladie (pathologique) est-elle opérationnelle en psychiatrie ?
On peut trouver un premier élément de réponse dans les deux catégories de critères retenus par l'OMS pour sa classification des
maladies :
critères relatifs à un appareil ou à un système,
critères relatifs à un organe.
Il est évident que, l'appareil psychique ne pouvant être réduit au cerveau ou au SNC, la psychiatrie aura du mal à décrire les maladies
psychiques à partir de ces éléments. Elle se tournera alors vers d'autres instruments lui permettant d'identifier son objet d'étude.
L'étude de Rösch sur la classification des maladies, dans l'enquête de 1970 sur les soins médicaux, peut permettre une meilleure
appréhension de la spécificité de la nosologie psychiatrique. (1) (10) Dans sa Taxonomie nosologique, Rösch identifie cinq niveaux de
définition des maladies, dont le degré de précision va en décroissant :
1. niveau de l'épidémiologie,
2. niveau de l'étiologie,
3. niveau de la lésion,
4. niveau du syndrome,
5. niveau des symptômes.
Santé Fonctionnement “ normal ”, physiologique
Maladie Dysfonctionnement “ pathologique ”
Traitement Thérapeutique
Dans le champ de la dépression, le problème est tout autre puisque certaines des émotions éprouvées par le malade font partie de la
large palette d'affects physiologiques vécus par un sujet non déprimé. Il s'agira donc de faire la différence entre la souffrance morale
normale et la souffrance morale pathologique. La définition de l'objet d'étude “ dépression ” implique donc un préalable : la définition de
l'humeur.
Jean Delay ne s'y est pas trompé lorsque, en 1946, dans Les dérèglements de l'humeur (2), il évoquait, en exergue, cette difficulté :
“ C'est une notion facile à entendre mais difficile à définir que celle de l'humeur (...) L'humeur est cette disposition
affective fondamentale, riche de toutes les instances émotionnelles et instinctives, qui donne à chacun de nos états
d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur. La
base de la vie affective est faite d'une échelle d'humeurs comme la base de la vie représentative d'une échelle de
conscience. ”
Cette définition pose le problème du continuum entre l'humeur normale et l'humeur pathologique, entre la tristesse et la dépression.
Est-ce une question de “ quantité ” de souffrance ou bien une question de “ qualité ” ?
Le modèle classique de la mélancolie, qui trouve son équivalent actuel dans la dépression majeure ou caractérisée, propose un premier
niveau de réponse : dans le cas de la dépression, il s'agit d'une tristesse qui n'est pas seulement particulièrement intense mais aussi
d'un type particulier, la douleur morale. De plus, le tableau clinique de la dépression ne saurait se résumer à cette tristesse, car il existe
d'autres symptômes : ralentissement, troubles somatiques, troubles du sommeil, anorexie...
Mais cette modélisation purement descriptive, où l'on se contente de circonscrire les limites du pathologique tout en répertoriant ses
différentes manifestations, amène naturellement un deuxième niveau de questionnement. Effectivement, dès que l'on se demande si
c'est l'humeur dépressive qui provoque les autres symptômes, on bascule dans les hypothèses ou théories explicatives. En effet, on peut
considérer que l'humeur dépressive constitue un “ symptôme primaire ”, duquel découlent les autres, qui sont alors des “ symptômes
secondaires ”. L'affect dépressif, à l'instar de la dissociation bleuleriène (spaltung) dans la schizophrénie, serait le processus primaire à
l'origine de “ symptômes fondamentaux ”, qui entraîneraient à leur tour une série de “ symptômes secondaires ”.
Selon cette conception “ jacksonienne ” des troubles thymiques, l'humeur dépressive prend une valeur paradigmatique et apparaît donc
comme le processus unitaire commun à toutes les formes cliniques de la dépression. Ce type de raisonnement est commun aux
différentes théories compréhensives. Ce qui diffère, c'est l'identification du processus primaire.
Depuis quelques années, la description de la sémiologie de la dépression s'est détournée progressivement de son axe central :
l'humeur. Ainsi, par exemple, l'école de La Salpétrière considère le ralentissement comme le syndrome essentiel à l'origine de
l'ensemble de la pathologie dépressive. (5) (12) Dans le cas de la dépression masquée, l'éloignement de l'axe “ douleur morale ” est
encore plus prononcé. Nous sommes devant un tableau clinique où les troubles thymiques sont soit absents, soit au deuxième plan,
“ masqués ” par des symptômes somatiques divers. Au point que, lorsque P. Kielholz a décrit cette nouvelle entité nosologique en 1973
(6), elle a été qualifiée par certains journalistes de “ dépression sans tristesse ”.
Ainsi, à l'heure actuelle, à côté du modèle de la “ dépression majeure ”, où les symptômes son apparents et intenses, on trouve :
Des formes cliniques où la symptomatologie thymique n'est pas apparente, car elle est camouflée par des plaintes
somatiques. C'est le modèle de la “ dépression masquée ”, et, par extension conceptuelle, celui des équivalents dépressifs comportementaux.
Les formes où la symptomatologie est apparente mais moins intense. C'est le modèle de la “ dysthymie ” et du large éventail
des dépressions subsyndromiques ou monosymptomatiques.
Cette hégémonie de la dépression réactionnelle a modélisé à son tour l'étiopathogénie, établissant un lien de causalité directe entre
l'“ événement vital ” et le trouble de l'humeur. Encore une logique réductrice, selon laquelle un individu soumis à un certain type de stress
psychosocial “ ne peut qu'être ” déprimé. Ces configurations psychopathologiques du relationnel se font au détriment de la prise en
compte des facteurs de vulnérabilité individuelle autant que des facteurs de “ protection ”.
Les programmes de prévention devraient être centrés davantage sur l'étude de ces paramètres et non pas seulement sur la dépression
elle-même.
Finalement, on est en droit de se demander si, en matière de soins et de prévention des états dépressifs, nos actions correspondent aux
attentes de la population.
Lorsqu'une personne fait part de sa souffrance morale à un des acteurs de la filière de soins, l’objectif n'est pas de ne pas prendre
forcément sa détresse existentielle pour une dépression, mais de trouver une réponse adéquate à chaque cas de figure.
Comme le rappelait Pierre Pichot (8) dans l'ouverture d'un symposium sur la révision des concepts des états dépressifs : “ Dans le
domaine de la dépression, nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins : il était peut-être nécessaire de
détruire, mais il est indispensable de reconstruire. ”
| Dernière mise à jour : jeudi 22 mars 2001 18:10:18 Dr Jean-Michel Thurin |
| 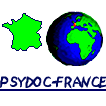
|