| Dernière mise à jour : jeudi 29 mars 2001 14:52:24 Dr Jean-Michel Thurin |
| 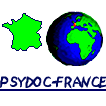
|
LA DEMARCHE QUI AMENE OU NON A CONSULTER
La prise en charge de la dépression est certainement insuffisante.
Beaucoup de dépressions ne sont pas traitées. L’évaluation de leur nombre est difficile, les chiffres de 50 % à 70 % sont avancés (1) (23)[1]. Quel que soit le nombre exact de ces dépressions, leur existence est un fait qui ne peut être nié. Ces malades ne consultent pas (ou, en tout cas, pas pour dépression) et, lorsqu’ils consultent, leur dépression n’est pas toujours identifiée.
Par ailleurs, un grand nombre de ceux qui consultent ne le font qu’avec beaucoup de retard.
On sait que les déprimés qui consultent s’adressent en majorité à des médecins généralistes. Ce fait ne peut être retenu comme la cause de la mauvaise prise en charge des déprimés, car les généralistes sont capables de traiter la dépression. Il peut néanmoins avoir des conséquences : les patients présentent un tableau de dépression qui peut induire les généralistes en erreur ; de plus, les médecins généralistes n’ont pas dans ce domaine une formation aussi complète que celle des psychiatres et leurs conditions de travail se prêtent parfois mal à cette identification. Il convient donc de prendre la mesure de ce phénomène.
Les déprimés s’avèrent être des usagers des services médicaux (généraux ou spécialisés – toutes spécialités confondues) trois fois plus assidus que la population non dépressive (3). En effet, la dépression, selon les différentes enquêtes, favorise le recours aux consultations médicales et aux services des urgences (7).
Plusieurs enquêtes s’accordent sur le fait que la dépression est essentiellement prise en charge par les médecins généralistes (70 %). Si le cabinet du MG apparaît comme le lieu de consultation spontané, il n’en reste pas moins que quelques patients déprimés consultent un psychiatre, soit directement, soit sur les conseils d’une autre personne.
Dans une enquête nationale concernant les modalités d’accès aux soins spécialisés pour les troubles psychiatriques (dont 26 % de dépressions en diagnostic principal et 42 % en diagnostic principal et associé), on a constaté que 22 % des sujets ont consulté pour la première fois un psychiatre de leur propre chef, 31 % sur les conseils de leur MG, 19 % sur les conseils d’un membre de leur entourage, 18 % après une hospitalisation, 5 % sur les conseils d’un spécialiste non psychiatre et 2 % sur les conseils d’un médecin du travail. (24)
Avant de consulter un
psychiatre, 64 % des patients ont fait appel à un médecin
non psychiatre, 25 % à un membre de leur famille, 6,5 %
à une infirmière ou à un psychologue, et 2,5 %
à un guérisseur ou à une voyante. (24)
La consultation auprès d’un généraliste est déjà tardive, elle l’est plus encore auprès d’un psychiatre. Les patients finissent par consulter en raison :
·
de l’aggravation
des troubles (42 %),
·
de l’insistance de
leur famille (28 %),
·
de l’apparition de
conséquences (19 %),
·
de l’influence de
l’information des médias (2,5 %),
·
pour d’autres
raisons (8,5 %). (24)
Et nous n’abordons pas les problèmes d’accessibilité aux soins : absence de spécialiste à proximité, listes d’attente exagérément longues, perte des droits à la Sécurité sociale, etc.
En Grande-Bretagne, Goldberg et Huxley (24) proposent un modèle qui illustre les différents “ filtres ” de l’accès aux soins spécialisés, à savoir :
·
filtre 1 :
décision de consulter ;
·
filtre 2 :
reconnaissance du diagnostic psychiatrique par le MG ;
·
filtre 3 :
décision d’en référer au psychiatre.
ce modèle illustre l’importance quantitative de la participation des généralistes dans la prise en charge des problèmes psychiatriques (filtre 3) et tout particulièrement de la dépression ; il montre également qu’une partie des personnes présentant des troubles psychiatriques ne consultent pas le circuit médicalisé (ne passent pas le filtre 1). Ainsi, en Grande-Bretagne, un malade sur quatre environ accède à des soins primaires et moins de 5 % à des soins spécialisés.
Aux USA, Wells et coll. (25) concluent que la dépression se situe à l’extrémité d’un continuum correspondant à des besoins ressentis importants et à un accès faible aux soins.
Dans une telle situation, si, comme on le pense, la prise en charge des déprimés est insatisfaisante, les raisons doivent en être cherchées à la fois du côté des patients et du côté des médecins. Nous allons voir ce qui, chez les déprimés, entrave cette prise en charge – nous distinguerons leurs difficultés à se percevoir comme déprimés et leurs difficultés à consulter – et ce qui, chez les médecins, freine l’action thérapeutique.
LES DIFFICULTES DES PATIENTS A IDENTIFIER LEUR DEPRESSION
Se dire “ je suis malade ” n’est déjà pas simple en cas de maladie physique. C’est encore plus problématique en cas de maladie psychique, notamment de dépression.
Une des raisons principales pour ne pas consulter (ou pour le faire tardivement) paraît être la difficulté du patient à reconnaître ses dysfonctionnements psychologiques personnels et, en particulier, les variations de son humeur.
L’humeur est conçue comme quelque chose d’abstrait (6) et il est donc difficile d’en reconnaître les variations.
Si le sujet prend conscience de ses troubles, soit il les perçoit comme psychologiques et les considère alors souvent comme non pathologiques, soit il les attribue à des causes organiques. Cela peut être un facteur de “ déviation ” de la demande de soins et ne pas toujours conduire à consulter ; en effet, les symptômes somatiques sont parfois considérés, tout autant que les symptômes affectifs, comme non pathologiques et expliqués par une cause naturelle comme le surmenage.
Dans le premier cas, le patient a tendance à attribuer ce qu’il ressent aux événements de la vie. Selon Jorm et coll. (9), les facteurs susceptibles de causer une dépression les plus souvent mentionnés ont à voir avec l’environnement social immédiat : problèmes quotidiens, événements traumatiques, perte d’un être proche. Ces résultats sont concordants avec d’autres enquêtes internationales. La qualité de l’environnement pendant l’enfance revient aussi souvent dans les réponses, ce qui s’accorde avec les résultats d’autres études. Les auteurs attirent l’attention sur le fait que les personnes censées avoir un plus haut niveau d’éducation sanitaire sont pourtant celles qui attribuent à l’environnement social la responsabilité quasi exclusive de la dépression.
Il a été observé, à partir des enquêtes menées aussi bien auprès des patients (4) que des praticiens (2), que le déprimé décrit les manifestations de sa dépression différemment selon qu’il s’adresse à un généraliste ou à un psychiatre.
Chez le MG, les trois symptômes prédominants (hormis les plaintes somatiques) sont la fatigabilité, l’anxiété et l’insomnie, alors que, chez les psychiatres, les symptômes prédominants sont l’humeur dépressive, les signes de douleur morale, les signes d’autodévalorisation et le ralentissement psychomoteur. Cela tend à montrer que, selon que le patient est conscient de symptômes affectifs ou de symptômes somatiques, il s’adresse à un psychiatre ou à un généraliste.
Dans le deuxième cas, lorsque le patient attribue ses troubles à une cause organique, sa méconnaissance de son état affectif est aggravée. Cette tendance se voit renforcée par le fait que la présentation du tableau dépressif peut comporter beaucoup de symptômes somatiques, voire se limiter à ce mode d’expression. La situation sera encore plus complexe quand la dépression apparaîtra comme une pathologie secondaire à une maladie somatique, ce qui n’est pas une conjonction exceptionnelle. Dans ce cas-là, il sera bien évidemment encore plus difficile de reconnaître la dépression.
Il existe des différences selon le contexte psychosocial.
Ainsi, une enquête psychosociale récente (12) montre que seul un quart des personnes considérées comme déprimées selon le DSM-III reconnaissaient un tel état lorsqu’elles étaient interrogées directement. En revanche, ces mêmes personnes avouaient ressentir des troubles tels que perte de l’appétit, du sommeil, de l’envie de vivre, et culpabilité excessive.
Dans une autre enquête menée par la même équipe, cette fois-ci auprès de mutualistes de la MGEN (13), on observe une relation inverse : plus de personnes se déclarent déprimées alors que moins de personnes présentent les signes reconnus de ce tableau clinique.
Les personnes de classe sociale basse ou élevée sont celles qui ont le plus de mal à reconnaître la dépression. Les professions intermédiaires sont celles qui acceptent le plus facilement de consulter, avec, de plus, l’utilisation relativement fréquente d’antidépresseurs. (14)
Une enquête de santé mentale en région parisienne (14) montre aussi la sous-utilisation des soins par les personnes bénéficiant du RMI : la moitié d’entre elles ne consulte pas, alors que l’on retrouve dans ce groupe un pourcentage élevé de troubles dépressifs. Un certain nombre de ces personnes s’adressent à des services sociaux pour demander une aide matérielle, manifestant par là à la fois leur souffrance et leur impossibilité d’en identifier la nature. Les travailleurs sociaux sont dans l’impossibilité de reconnaître la dépression, car les sujets cachent leurs symptômes et eux-mêmes ne sont pas formés pour cela. De ce fait, l’assistance qu’ils s’efforcent d’apporter n’est pas efficace puisqu’elle ne répond pas au besoin majeur. (5) Ces résultats concordent avec les études anglo-saxonnes : les personnes des milieux défavorisés identifient moins facilement la dépression et ont moins tendance à demander de l’aide pour cet état. De plus, lorsqu’elles la demandent, la dépression est sous-diagnostiquée et la prise en charge souvent inadéquate. (Bebbington et coll. cités in 21)
L’âge et le sexe jouent un rôle essentiel dans cette identification de la dépression, non seulement du côté du patient – les jeunes reconnaissent mal leurs variations affectives (16) et les sujets âgés l’assument comme une situation adaptée ; les femmes communiquent mieux les affects que les hommes, etc. – mais aussi du côté de la relation aux autres, dont la relation au médecin n’est pas exclue. Ainsi, l’entourage et le médecin auront du mal à reconnaître la dépression de l’adolescent et du sujet âgé, pour ne citer que ces deux exemples. Dans les deux cas, c’est la notion même d’état pathologique qui n’est pas bien admise. (18)
L’emploi de l’étiquette de dépression varie selon le sexe et l’origine rurale ou urbaine. En milieu urbain, la dépression est ainsi plus souvent associée aux femmes de moins de 40 ans, sans pour autant que ces femmes soient déprimées au sens du trouble psychiatrique reconnu. En milieu rural, en revanche, cette étiquette n’est jamais employée pour les hommes, alors que certains d’entre eux réunissent les critères DSM-III de dépression majeure. (11)
Certains facteurs peuvent faciliter la reconnaissance de la dépression par le patient, mais seulement dans certaines limites. Ainsi, la présence de symptômes anxieux aidera à repérer la dépression, notamment chez la femme, mais elle constituera un élément de confusion lors de la prescription du traitement, les anxiolytiques étant dans ce cas-là plus prescrits que les antidépresseurs. (6)
De même, la sévérité de la dépression est une caractéristique qui contribue à sa reconnaissance (6) et qui favorise l’utilisation de soins (14), mais moins qu’on aurait pu l’espérer, parce que cette sévérité est souvent sous-estimée aussi bien par le patient que par son entourage. Dans cet ordre d’idées, il est à noter que bon nombre de dépressions, pourtant caractérisées, ne sont pas reconnues du fait de leur sévérité moyenne.
Les conséquences invalidantes de la dépression orienteront aussi bien l’entourage que le MG vers le diagnostic de dépression. (14)
Pour le public, la notion de dépression semble être étroitement liée aux aspects visibles du comportement, notamment à l’incapacité d’accomplir des rôles sociaux, et ignorer les aspects plus intériorisés des affects dépressifs, faute de pouvoir les identifier. Le public reconnaît probablement la présence de tristesse et d’insatisfaction, mais cela ne lui suffit pas pour appeler cela dépression, comme nous l’avons vu. Le public perçoit bien cependant les signes extérieurs d’anxiété, ce qui n’est pas très surprenant, puisque la “ dépression ” est souvent synonyme de “ surmenage ”. Ces constatations suggèrent que le concept “ dépression ” sert essentiellement à identifier une sorte de cassure psychologique, comme un état de crise avec des manifestations qui tranchent sur le comportement ordinaire de la personne et l’empêchent d’accomplir ses rôles quotidiens. (11)
Il est intéressant de noter que les patients qui ont déjà vécu une expérience personnelle de dépression ont une image plus proche du modèle médical. (20)
On peut résumer les conclusions de ces études de la manière suivante. Ce problème de la non-reconnaissance de la maladie n’est pas propre à la dépression. C’est un problème commun à toutes les pathologies. Qu’il s’agisse de douleurs ou de troubles fonctionnels, la prise de conscience de leur caractère pathologique est très variable d’un sujet à un autre. A sémiologie égale, certains se perçoivent malades et d’autres non. Certains sujets “ s’écoutent ” plus que d’autres, certains se plaignent plus facilement que d’autres, certains sont moins résistants que d’autres...
Cependant, il est un facteur qui semble propre à la dépression et qui constitue un obstacle fréquent à la prise de conscience par un déprimé qu’il est déprimé : c’est la difficulté à reconnaître les troubles de l’humeur. Souvent, le sujet ne les identifie pas comme des dysfonctionnements ou, quand il le fait, il les considère comme un phénomène de la vie psychique normale et les attribue à une difficulté de la vie.
Dans une perspective d’éducation sanitaire, il faudrait envisager une information sur ce que sont les affects dépressifs, et sur le fait qu’ils sont des symptômes pathologiques et qu’ils justifient que celui qui les éprouve se dise malade.
LES DIFFICULTES A CONSULTER
Se savoir (ou se croire) malade est la condition nécessaire pour consulter, mais non la condition suffisante. Il faut aussi avoir envie de guérir, penser que c’est possible, s’autoriser à demander, avoir confiance dans les consultants sollicités... sans parler des motivations inconscientes. Cela est vrai pour tous les types de maladies et encore plus pour la dépression.
Un premier obstacle réside dans la symptomatologie. Tout ce que ressent le sujet s’oppose à ce qu’il prenne conscience de sa maladie et entrave les démarches qu’il pourrait faire pour demander de l’aide. Ayant perdu tout espoir, il ne peut imaginer qu’il puisse guérir et, d’ailleurs, il ne le souhaite pas. Le monde lui paraît sans intérêt et il n’a plus envie de rien. S’il se sent coupable, il aspire à expier et non à guérir. Si la guérison lui paraît possible, il pense ne pas la mériter. Son manque d’énergie lui paraît une faiblesse, il en a honte et il n’envisage pas d’en parler et encore moins de s’en plaindre. Ainsi, ou il ne se sait pas malade, ou, s’il le sait, il ne croit pas pouvoir guérir et, s’il l’envisage, il estime ne pas le mériter.
Tout cela est connu depuis longtemps, mais il existe à l’heure actuelle d’autres phénomènes liés à notre culture et au contexte social.
Une étude australienne (9) menée en population générale (plus de 1 000 participants) a porté, entre autres, sur la représentation des causes psychiques de la dépression.
La moitié de la population interrogée signale la vulnérabilité individuelle comme cause principale de dépression, liée à une sorte d’anxiété permanente (neuroticism). L’étiologie le plus souvent évoquée est la faiblesse de caractère, puis l’infection virale, et enfin l’origine génétique.
Les auteurs soulignent avec inquiétude l’extension de cette première “ cause probable ” de dépression, laquelle est probablement responsable de la stigmatisation de la dépression et du sentiment de honte chez les sujets (encore trop répandu !) à souffrir de cette maladie. La “ faiblesse de caractère ” en tant que cause de dépression est fortement corrélée à une faible capacité à reconnaître les symptômes de la maladie et, cela va de soi, à consulter.
De plus, il existe dans notre société une image péjorative de la médecine et des soins médicaux pour ce qui concerne la dépression.
L’enquête de Jorm (8) a révélé des divergences importantes entre le public et les professionnels dans leur jugement de la valeur thérapeutique des différentes approches ; cela est susceptible d’entraver la disponibilité des gens à demander et à accepter de l’aide d’une part, et à rester observants du traitement proposé d’autre part.
Les professionnels de la santé auraient une tendance à négliger ces différences lors de la relation au patient. L’auteur conclut sur l’intérêt de diminuer cet écart pour favoriser l’alliance thérapeutique.
La recherche de L. Cooper (3) menée aux USA met en exergue le fait que beaucoup de patients recourent à la spiritualité et à la religion pour gérer leur dépression ; cela est bien plus marqué chez les déprimés noirs que chez les blancs. Les sujets noirs sont plus enclins à chercher du soutien et des conseils auprès des membres d’une église.
Dans cette même étude, les personnes consultées reconnaissent majoritairement la place importante des proches comme soutien, en même temps que leur faible influence au moment de la période aiguë de l’épisode dépressif et la gêne éprouvée d’avoir à recourir à eux à ce moment de l’expérience dépressive.
Wells et coll. (25) concluent que la raison commune pour ne pas recourir à l’aide d’un professionnel en cas de perturbations psychiques, quelle que soit la personne interrogée, est le doute sur ce besoin de traiter ce qui concerne des problèmes émotionnels. Les personnes interrogées croient pouvoir s’en sortir toutes seules. Cette raison apparaît bien plus importante que celles d’ordre structurel (coût, distance, horaire, information sur les services, etc.).
A propos des soins, l’étude australienne déjà citée (9) a constaté que 83 % des sujets considèrent qu’une prise en charge par le médecin généraliste suffirait ; 74 % pensent en termes positifs à une prise en charge par un conseiller (counsellor) – services d’écoute téléphonique, associatifs ou autres ; moins nombreux sont ceux qui croient à l’intérêt d’impliquer un psychiatre (51 %) ou un psychologue (49 %) dans les soins. La plupart des traitements psychiatriques classiques (antidépresseurs, ECT, hospitalisation) sont surtout jugés comme pouvant causer plus de préjudices que de bénéfices. Il en va de même pour les psychothérapies, alors que des soins “ alternatifs ” (l’augmentation de l’activité sociale et sportive, la relaxation, les techniques de gestion du stress, la lecture individuelle d’ouvrages traitant de la question, les vitamines et les régimes alimentaires) sont nettement préférés.
Jorm et coll. (8), dans une étude en population générale, ont aussi constaté que les personnes consultées croient volontiers au pouvoir thérapeutique des soins “ alternatifs ” (homéopathie, régimes spéciaux, cures vitaminiques, tonifiants, relaxation et yoga).
Les médicaments ont une image particulièrement péjorative. Ils sont vus comme peu ou pas efficaces, donnant des effets secondaires, créant une dépendance et nécessitant une prise de très longue durée.
R. Priest (23) a étudié les attitudes spontanées de la population à l’égard de la dépression (sur un échantillon de 2 003 sujets). Une grande majorité (78 %) considère que les antidépresseurs entraînent une dépendance pharmacologique et qu’ils atténuent les symptômes sans résoudre le problème. Seulement 16 % des participants considèrent les antidépresseurs comme une thérapeutique de choix pour la dépression ; 91 % pensent que l’action d’un conseiller (counsellor), particulièrement à travers un travail groupal de partage d’expériences, est un traitement idoine et efficace.
La psychothérapie a également une image péjorative. Dans une étude menée au Québec (11) auprès de 3 291 personnes, les sujets interrogés sur la psychothérapie mettent surtout en avant leurs interrogations sur son efficacité, sur la fréquence des séances et la durée d’un traitement.
Beaucoup de déprimés ont aussi la conviction que, s’ils se présentent comme déprimés, ils vont être mal jugés. Bien que le médecin de famille apparaisse comme le professionnel le plus approprié pour traiter la dépression (79 %), la majorité (60 %) des sujets interrogés par Priest et coll. (23) exprime une réticence à en parler à son médecin, dénotant une forte ambivalence à consulter. Il est très intéressant de noter que, malgré l’expression d’une attitude bienveillante à l’égard des sujets qui souffrent de dépression, les répondants semblent projeter sur le corps médical l’image négative qu’ils possèdent de la maladie : ils affirment penser que les MG jugeraient avec irritation comme étant un “ névrosé ” ou un “ déséquilibré ” celui qui se plaindrait devant eux de dépression.
Le psychiatre est perçu comme le spécialiste prenant en charge les cas graves, ce qui est censé expliquer le peu de recours spontané à sa consultation ; de plus, il ressort nettement que le mot “ psychiatre ” est fortement connoté et stigmatisé, et qu’il réveille beaucoup d’appréhensions.
Une autre difficulté est mise en évidence par Ogden et coll. (20). Si la présentation de la dépression est essentiellement somatique, le patient aura du mal à accepter le diagnostic de dépression proposé par le MG, et l’observance du traitement sera bien sûr mauvaise.
Une autre cause de désaccord entre le MG et son patient peut être la nature de la dépression.
Enfin, le fait que le patient accepte le diagnostic proposé par le MG et son traitement ne s’accompagne pas toujours d’une modification de la représentation de la maladie.
Les patients ont aussi souvent l’impression que leur demande n’est pas comprise. Noble et coll. (19) ont fait une revue de la littérature concernant les demandes des patients, publiée récemment dans Acta Psychiatr. Scand., Elle avait pour but d’identifier les types de demandes adressées par les patients aux services de santé mentale, la perception de ces demandes par les psychiatres, et la relation entre ces demandes et l’évolution des soins. Cette revue a recensé vingt-huit publications originales, essentiellement nord-américaines, sur une période de trente ans dont très peu datent de ces dernières années.
Ces études montrent qu’il y a un certain dénominateur commun dans les demandes adressées aux services de santé, indépendamment du type d’unité spécialisée. Les patients demandent essentiellement des approches psychologiques ; les demandes qui reviennent le plus souvent sont des demandes d’” éclaircissements ”, d’” expertise psychologique ” et de “ compréhension psychodynamique ”.
Il apparaît clairement que les patients sont en général inhibés pour exprimer ces demandes lors de la consultation et que les psychiatres négligent souvent l’exploration de ces demandes. Interrogée d’une manière systématique, la majorité des patients qui s’adressent aux services spécialisés présente des demandes, indépendamment de l’âge, du sexe, du niveau socioéconomique et de l’ethnie. Seuls ceux qui ont des antécédents psychiatriques formulent des demandes plus précises. Du côté des psychiatres, il apparaît qu’ils surestiment le besoin de “ confession ” (aveu), de contrôle des émotions, de réassurance et de “ livrer à la discussion ”, en même temps qu’ils sous-estiment les besoins d’éclaircissements et de compréhension psychodynamique.
On voit donc que les principaux obstacles à consulter sont :
·
le vécu
même de la maladie dépressive (désespoir,
culpabilité...), qui freine toute demande de soins (on ne voit pas
comment modifier cet état affectif mais on peut envisager
d’attirer l’attention de l’entourage sur ce fait) ;
·
la stigmatisation du
terme de dépression, qui fait que le sujet a peur d’être mal
considéré s’il fait état de ses troubles ;
·
l’image très
péjorative des traitements – et particulièrement la
chimiothérapie – opposée à des images favorables des
soins “ alternatifs ” (c’est là un
problème majeur) ;
·
une image
également assez péjorative de la compréhension que les
médecins peuvent avoir de la demande du patient : demande
d’explications et d’éclaircissements.
Il est souhaitable pour la santé publique de faire évoluer les représentations liées à la dépression. Cela serait utile aux malades pour qu’ils identifient leur trouble et demandent de l’aide, aux familles pour qu’elles repèrent la dépression et sachent conseiller un membre de la famille qui souffre, à la population en général pour qu’elle ait une idée réaliste de la dépression, ni banalisée, ni dramatisée.
Il faut en déstigmatiser l’image courante, lui enlever son sens de faiblesse de caractère, de fragilité, de manque de courage.
Il faut qu’elle soit reconnue comme une vraie maladie :
·
qui est source de
souffrance et qui altère gravement la qualité de vie ;
·
qui nécessite un
vrai traitement et qui ne guérira pas par un simple effort de
volonté ou par quelques encouragements amicaux ;
·
qui est
guérissable ;
·
dont il faut
s’occuper le plus tôt possible ;
·
pour qui le meilleur
recours est la médecine.
Il faut enfin déstigmatiser les médicaments. Ils ne sont pas tout dans le traitement mais ils jouent un rôle majeur. S’ils sont choisis et prescrits avec compétence, ils sont efficaces, ne sont pas toxiques, n’entraînent pas de somnolence ou d’adynamie et ne créent pas de dépendance.
Il faut informer le public du fait que, souvent, les déprimés ont des difficultés pour demander de l’aide et qu’il faut aller au devant d’eux sans attendre qu’ils fassent la démarche de consulter.
| Dernière mise à jour : jeudi 29 mars 2001 14:52:24 Dr Jean-Michel Thurin |
| 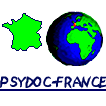
|