
 |
Parcours d'un chercheur en santé mentale à l'Inserm |
Françoise Casadebaig a pris sa retraite ! Pour la génération actuelle des psychiatres, elle a représenté avec Nicole Quemada (qui a fait partie du comité de rédaction de cette revue) la recherche à l’INSERM consacrée aux patients recevant des soins psychiatriques.
Comme elle le raconte ici de manière évocatrice, les contacts persévérants et la collaboration au long cours avec les praticiens « de terrain » (et avec leurs secrétaires !) lui ont permis de créer - puis de faire croître - l’intérêt pour la connaissance quantitative de l’activité réalisée. Quels combats Françoise Casadebaig ne raconte-t-elle pas ? Auprès des psychiatres après 1968 et la grande peur du « flicage », mais aussi auprès des organismes officiels. Il y a eu des victoires, comme les enquêtes « à jour donné » grâce au soutien de la Direction générale de la santé, ou LA cohorte, grâce à des soutiens successifs. Il y eu aussi des défaites, qui ne font pas honneur à la recherche française, comme les conditions dans lesquelles on a laissé Nicole Quemada finir sa carrière, ou l’absence de successeur pour l’une comme pour l’autre.
Depuis très longtemps aucun chercheur n’a été recruté pour étudier les données quantitatives à propos des personnes qui reçoivent des soins psychiatriques. Par rapport à ce que font de nombreux autres pays européens, nos grands instituts de recherche montrent dans ce domaine un effacement qui évolue vers l’absence totale. Tant que la France négligera ces questions, nous pourrons continuer à idéaliser ces chiffres qui nous manquent tant et qui nous effraient davantage ; nous pourrons continuer à rêver des données qui expliquent tout ou à exécrer les programmes qui contrôlent chacun. Françoise Casadebaig nous le dit : la recherche, c’est une pratique. Cette pratique se définit par ses limites autant que par ce qu’elle apporte. Beaucoup de travail, beaucoup de méthode, beaucoup de persévérance sont nécessaires pour obtenir quelques résultats qui doivent ensuite être interprétés avec prudence.
Ce témoignage mérite d’être écouté. Sa modestie fait aussi sa grandeur.
PLR - Votre démarche de chercheur se situe t-elle dans le cadre de votre formation ?
Non mais tous les chemins mènent à Rome... J’ai fait des études de sociologie et de démographie (notamment démographie historique) à la Sorbonne et à l’Institut national d’études démographiques (INED). J’ai atterri à l’INSERM par hasard en 1971. Le Docteur Raymond Sadoun montait son équipe qui fut pendant 12 ans l’unité 110 de L’INSERM sur les troubles mentaux de l’adulte et de l’enfant et Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS). Il avait besoin de quelqu’un dont le profil pouvait me correspondre. Par la suite, j’ai fait de l’épidémiologie car si certaines méthodes sont communes à la démographie et à l’épidémiologie, d’autres sont cependant plus spécifiques de l’épidémiologie. On peut rappeler au passage qu’au départ la démographie est une science d’origine essentiellement française alors que l’épidémiologie est d’origine anglo-saxonne.
Dans un premier temps, j’ai élaboré le recueil des données du centre de pédo-psychiatrie Alfred Binet et j’ai assuré leur exploitation jusque vers les années 1980. Les notions de névrose et de psychose m’étaient alors assez inconnues et j’ai donc suivi les séminaires de Serge Lebovici avec lequel j’ai pris un grand plaisir à travailler. Je me souviens encore avec amusement de discussions entre René Diatkine et Serge Lebovici à propos de cas, discussions qui devenaient à certains moments plutôt confusionnelles pour une béotienne comme moi.
Durant ces mêmes années, nous nous étions déjà tournées avec Nicole Quemada vers des études sur les clientèles adultes prises en charge en psychiatrie. Nous avons fait les premières études de clientèles, à partir d’une Action Thématique Programmée (ATP) de l’INSERM. On avait concouru pour cette ATP et nous avions pu ainsi obtenir des crédits. Nous avons fait un petit tour de France, modeste, une dizaine de secteurs pour recruter des collaborateurs (1975). Quelques années après, dans les années 1982, on a refait cette étude avec un plus grand nombre de secteurs.
Dans le prolongement de ces études de clientèles, il a été décidé, avec l’aide de la Direction Générale de la Santé (DGS), de faire une coupe transversale à peu près tous les 5 ans, d’une part sur les adultes, d’autre part sur les enfants. Je n’ai pas participé à l’étude sur les enfants, mais pour les adultes Nicole Quemada a réalisé une première coupe transversale d’un secteur sur deux en 1993. En 1998, nous avons refait cette coupe transversale en l’élargissant alors aux cliniques privées et aux établissements de post-cure. Nous avons eu 95 % de réponses des secteurs, 92% des établissements de post-cure et 88% pour les cliniques privées. C’était un taux de réponses assez remarquable.
PLR : Comment expliquer ce fort taux de réponses ?
Je crois que nous avons été très proches des secteurs de psychiatrie. Nous nous sommes beaucoup déplacées sur le terrain. Nous avons pris beaucoup de contacts et je crois que, d’une façon générale, cela a permis que s’instaure un dialogue permanent avec nos collaborateurs. Nous n’avons jamais trahi leur confiance. Par exemple, nous avons toujours refusé de faire des recherches d’activité au niveau du secteur même. Méthodologiquement, cela ne voulait rien dire car les données devenaient trop peu nombreuses pour être valides et par ailleurs cela pouvait laisser se développer l’idée que ce secteur serait moins bien selon tels ou tels critères que celui d’à coté. Nous avons inauguré ce type de recherche en santé mentale. Je crois que quelqu’un comme Nicole Quemada a beaucoup apporté au recueil des données en santé mentale dans ce pays et, encore une fois, on peut déplorer la façon dont on l’a laissée partir. Elle s’est retrouvée, dans les dernières années, seule dans un bureau sans secrétaire et sans moyens, même pour effectuer son déménagement. Ce n’est ni à l’honneur de l’INSERM ni à celui de la profession psychiatrique qui aurait pu se mobiliser, connaissant son travail notamment dans le domaine des classifications nosographiques.
Quand nous avons commencé, elle et moi, l’épidémiologie dans ce domaine était balbutiante en France. Nous avons par la suite ouvert la porte à des jeunes. L’impact de Raymond Sadoun a été important à travers l’OMS, car il parlait très bien anglais, ce qui nous a permis de rencontrer des épidémiologistes anglo -saxons de renommée mondiale.
PLR – Pouvez-vous nous expliquer de façon simple ce qu’est une coupe transversale ?
Une coupe transversale est une photographie d’une population à un moment donné ou un jour donné, alors qu’une cohorte permet de suivre une évolution dans le temps. Il existe deux types de cohortes, les cohortes fermées, (comme la mienne, par exemple) de patients qui vont vieillir dans le temps et les cohortes ouvertes où des patients vont venir s’inclure dans une cohorte au fur et à mesure du déroulement de la recherche.
Les coupes transversales répétées dans le temps permettent de repérer une évolution. Par exemple, les différentes coupes transversales montrent les évolutions des prises en charge comme la diminution du nombre de patients hospitalisés à temps plein.
PLR – En quoi ces études peuvent-elles être utiles pour un clinicien ?
Cela permet au clinicien de situer son activité par rapport à un repère national. C’est un dénominateur précieux. La file active est un autre mode de connaissance. Si l’on veut connaître combien il y a eu de schizophrènes pris en charge dans une année, c’est la file active qu’il faut.
PLR – En quoi la connaissance de la file active peut-elle être utile pour l’administration ?
Pour l’administration, la file active est, avec les coupes transversales, ce qui lui permet d’appréhender l’activité des services, les types de populations prises en charge et les évolutions de l’un et de l’autre en fonction des politiques qu’elle met en place. Il y a des fermetures de lits depuis 20 ans maintenant de façon régulière. Elle a besoin de savoir à un moment donné combien de patients sont traités dans les hôpitaux à temps plein, en ambulatoire, ou en prise en charge à temps partiel et qui ils sont. Est-ce qu’il existe des caractéristiques qui poussent davantage à un certain type de prise en charge qu’à un autre. ? Elle a besoin de ces repères quantitatifs pour pouvoir établir ses prospectives de soins pour la population. Par exemple, si l’on considère les populations qui sont prises en charge durant une longue période dans les hôpitaux, que vont-elles devenir si l’on ferme les lits ? Si elles ne sont pas capables de vivre de façon autonome, il faut prévoir d’autres structures. Ces études doivent servir à la planification des politiques administratives.
PLR –Vous parliez tout à l’heure d’aller sur le terrain. Est-ce pour votre plaisir ou par nécessité ?
Les deux, parce que cela permet de débattre des problèmes méthodologiques de façon plus directe et donc plus efficace. Cela permet également de mieux se rendre compte de ce que l’on attend de nous. Cela facilite l’explication des objectifs poursuivis, pourquoi on veut les atteindre et comment on veut les atteindre. Et enfin, c’est plus convivial de connaître ses interlocuteurs. Toutefois, le travail de la cohorte a été mené par courrier et par téléphone, mais cela a toujours été un grand plaisir de rencontrer des participants au cours de congrès, par exemple.
PLR – Avez-vous rencontré des résistances de la part des cliniciens par rapport à vos activités ?
Parfois, avec quelques anecdotes. Les années 1975 se ressentaient encore de 1968 : « Ils ne sont pas plus malades que vous et moi, pas de diagnostic, cela stigmatise ; pas d’enregistrement de la profession, voire de l’état matrimonial, tout ça c’est du flicage ». On a connu ce genre de discours avec Nicole Quemada, au cours de nos différentes pérégrinations. Quand nous exposions les différents paramètres que nous voulions enregistrer pour les études de clientèles, nous avons parfois eu ces tirs de barrage. Nous répondions : on vous parle du secteur, donc vous allez prendre des patients en ambulatoire. Cela peut-être intéressant de savoir s’ils ont une famille, des moyens de subsistance, etc. Non, tout cela était balayé.
Dans un service parisien notamment, nous nous étions déplacées plusieurs fois à la demande du chef de service et, à chaque fois, nous nous étions heurtées à une opposition farouche. Un jour, nouvel appel du chef de service. On recommence notre exposé, nouveau tir de barrage et tout à coup, le chef de service tape du poing sur la table et dit « Eh bien cette recherche se fera car je le veux !». Silence général et depuis, ils n’ont plus cessé de faire des recherches.
J’ai également un autre souvenir. Un professeur de province nous avait demandé de venir. Très aimablement, il nous reçoit chez lui puis nous rejoignons son service. Il y avait une vingtaine de personnes autour de la table. Tout le monde reste assis sans nous saluer. Nous commençons à exposer le projet dans un silence à couper au couteau. A 5 heures, tout le monde s’est levé et est parti, en plein milieu de la phrase de l’une de nous. Inutile de dire que la recherche ne s’est pas faite dans ce secteur.
Une fois également, à l’institution A. Binet, j’avais proposé d’enregistrer l’origine ethnique des enfants. Pour moi l’idée sous-jacente était : si c’est un petit garçon qui vient du fin fond du Maroc et que la maman ne parle pas un mot de français, ce serait peut être bien de le mentionner et d’avoir au total une notion précise du nombre d’enfants concernés. Non, non et non. Puis un jour, la fréquence de ce type de problème est devenue telle que le Centre a souhaité avoir des données quantitatives qui n’étaient évidemment pas disponibles puisque jamais enregistrées.
Parallèlement aux études dont je viens de parler, je m’étais intéressée à la mortalité des malades mentaux. J’avais lu des textes étrangers sur ce sujet et j’avais été ainsi étonnée de voir que les malades mentaux avaient une surmortalité déjà confirmée par les études étrangères. J’en avais parlé à Serge Lebovici qui m’avait dit : « très bonne idée, il faut absolument que l’on fasse ça ». Il avait une de ses élèves qui était dans un grand centre psychiatrique parisien et on a élaboré un pré questionnaire. Le résultat a été catastrophique. Cette idée a été très mal reçue, nous n’avons pas compris pourquoi. J’étais très étonnée que des médecins ne veuillent pas s’intéresser à la mortalité de leurs patients. Cela tombait peut-être à un mauvais moment, ou bien il y a eu des maladresses dans la présentation du projet. Je n’en sais rien, mais j’ai décidé de ne pas abandonner ce projet et je me suis tournée vers les statistiques établies annuellement par les hôpitaux psychiatriques (Etats SP7) et exploitées à l’Unité 110. Ces statistiques ont existé de 1968 à 1978. Il faut reconnaître le peu d’enthousiasme des services à tenir ces statistiques. Ce travers est bien français de considérer qu’établir des statistiques, c’est perdre son temps. Cela prouve que leur utilité n’est pas assez mise en valeur. Ces statistiques étaient des statistiques d’événements (nombre d’hospitalisation...), mais elles enregistraient les décès qui s’étaient produits dans l’année et faisaient un recensement de la population hospitalisée au 31 Décembre. Avec des méthodes démographiques appropriées, on a pu ainsi étudier la mortalité des malades mentaux hospitalisés depuis le début, c’est-à-dire depuis 1968. Après 1978, les crédits ont manqué et l’intérêt de ces statistiques n’apparaissant pas à l’INSERM, elles n’ont plus été faites que tous les deux ans,1980, 1982. Elles ont fini par disparaître avec la fermeture de U 110. Parallèlement à l’époque, dans les fichiers nationaux des causes de décès, étaient répertoriés également ceux des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques, avec leur cause. Cet enregistrement a également disparu dans les années 1982. La raison invoquée était que le suivi des patients devenait essentiellement ambulatoire. Je m’étais élevée contre cette décision en soulignant qu’il y avait toujours et qu’il y aurait toujours des patients hospitalisés et qu’il était d’un grand intérêt de suivre l’évolution de cet événement parallèlement même à l’évolution des populations hospitalisées. Ma voix fut bien isolée. Je crois savoir que la Direction de la recherche et des études statistiques en économie de la santé (DRESS) s’intéresse beaucoup à nouveau à cette question et regrette qu’il y ait eu rupture de ces statistiques.
PLR – Et leur implications ?
Après la fin de l’Unité 110, j’ai rejoint l’Unité 302 de l’INSERM, sur la psychopathologie et pharmacologie des comportements, dirigée par le Daniel Widlöcher. Avec son accord, j’ai décidé de continuer les recherches sur la mortalité, en tenant compte de l’ensemble des prises en charges. Avec la collaboration du Groupe Français d’Epidémiologie Psychiatrique (GFEP), nous avons monté une pré-enquête sur la mortalité des patients, pas seulement hospitalisés mais également suivis en ambulatoire. Contrairement à l’aventure vécue avec Serge Lebovici, cette étude a été très bien reçue par les psychiatres.
A la suite de cette pré-enquête, en 1993 et avec la collaboration d’Alain Philippe, ingénieur dans cette Unité, j’ai pu monter une cohorte de patients schizophrènes en lançant un appel à collaboration aux psychiatres, à travers leurs principales revues. Nous avons également contacté tous les membres du GFEP et j’ai été très soutenue dans cette entreprise par Thérèse Lempérière. Les résultats de la pré-enquête nous ont montré un taux de mortalité dépassant 1% par an. Nous avons donc visé une inclusion de 3000 patients pour obtenir au moins une trentaine de décès annuels. Finalement 3500 patients ont été inclus à travers 122 secteurs psychiatriques qui ont accepté de participer bénévolement à cette recherche. Dix ans plus tard, une centaine de secteurs continuent à participer. Les mutations de psychiatres d’un secteur à un autre ont été la cause principale des abandons. Dans les faits, il y a eu beaucoup plus de mutations que la vingtaine de secteurs manquants, mais dans la majorité des cas, la recherche a été reprise par quelqu’un d’autre du secteur. Cette recherche a toujours été très soutenue également par la DGS. Dans les années 1998, nous avons concouru auprès de la Fondation pour la Recherche Médicale à un appel d’offre proposé « Action Recherche Santé 2000 ». Dans un premier temps, chacune des sociétés savantes devait retenir 3 projets de recherche. Parmi ces trois projets, La Fédération Française de Psychiatrie avait retenu la recherche sur la mortalité des malades mentaux. La seconde étape était un rapport assez bref. On aboutissait à un total de 20 rapports retenus. Dans un troisième temps, il fallait écrire un rapport conséquent, en anglais car envoyé pour une évaluation à l’étranger. Sur les 20 retenus à ce stade, ils en éliminaient 10. Là, c’était stressant car les 20 avaient fourni le même important travail. Le nôtre a été retenu et cela nous a apporté un ballon d’oxygène d’un million de francs qui nous a permis jusqu’à ce jour de continuer l’observation annuelle de cette cohorte soit maintenant dix ans.
A priori, c’était ce que nous avions prévu : 10 ans d’observation. Toutefois, étant donné ce qui s’est passé cet été, et dans la mesure où c’est le seul indicateur fiable en France pour mesurer si éventuellement la canicule a eu un impact sur la santé d’une population vulnérable comme celle des patients schizophrènes, il a été décidé de poursuivre l’observation deux années de plus. Il faut rappeler que notre étude situe la mortalité globale des patients à plus de 4 fois celle de la mortalité générale, 2 fois et demie en ce qui concerne les maladies somatiques et 15 fois pour le suicide. Bien évidemment tout le monde finit par mourir. Parler de surmortalité veut dire que pour un âge donné, on observe par exemple toutes causes de décès confondues, 4 décès de patients pour un décès en population générale. On peut ainsi parler d’une espérance de vie beaucoup plus courte pour les patients, au moins une dizaine d’années. Cette cohorte montre une vulnérabilité des patients schizophrènes pour toutes les causes somatiques. Elle infirme une idée qui était prévalente dans les années 90, à savoir que les schizophrénes présentaient moins souvent des cancers que la population générale. Des études, menées notamment à partir des registres danois sur les patients schizophrènes, montraient en particulier moins de cancers des voies respiratoires. Cela qui était assez étonnant puisque a priori ces patients schizophrènes sont généralement reconnus comme étant de grands fumeurs.
Par ailleurs, des études (danoises également), montraient que des phénothiazines pouvaient avoir un effet protecteur quant au développement des cellules cancéreuses. La thèse des auteurs danois, dont l’excellence des recherches est reconnue par tous, était que le strict contrôle de la consommation du tabac dans les hôpitaux danois pouvait être une des explications de ce résultat. C’est un argument qui m’a beaucoup étonnée car, au Danemark, comme ailleurs dans les années 1990, les patients ne passaient qu’un temps relativement court dans les hôpitaux. Rentrés chez eux, ils pouvaient très bien fumer. En France, les psychiatres reconnaissent que leurs patients schizophrènes sont de grands fumeurs. Où en est-on aujourd’hui sur cette question ? Après de nombreuses années d’observation, plusieurs études dont la nôtre montrent plutôt une surmortalité par cancer des voies respiratoires. Tout comme en population générale, le fait de fumer accroît pour eux aussi les risques de cancer du poumon. Une étude finlandaise publiée il y a un an environ a étudié, en plus, les proches des patients schizophrènes et a recherché comment ils se situaient par rapport au cancer. Les familles ne se situaient pas à un niveau supérieur à celui de la population générale. L’étude conclut que la surmortalité par cancer des patients n’est pas à rechercher du côté de la génétique mais du coté des comportements des patients. Pour cette étude, comme au Danemark ou dans d’autres pays du nord de l’Europe, les chercheurs ont la possibilité de croiser leur fichier national de population, et des fichiers de patients. Face à ces possibilités, il faut reconnaître qu’en France on bricole !
Ce que nous voulons voir également à travers cette étude, c’est comment évolue le suicide des patients schizophrènes au fur et à mesure de leur vieillissement et parallèlement de leur éloignement du début de leur pathologie. Il est en effet reconnu que les patients jeunes et/ou en début de maladie constituent un groupe particulièrement à risque. Dans les 3 ou 4 premières années, la moitié de nos décès étaient des suicides, alors qu’à 6 ans, ils ne constituent plus que le quart, ce qui situe encore le suicide des patients à un niveau très supérieur à celui de la population générale. D’une part, sous l’effet de la sélection (les patients les plus à risque sont déjà décédés) et avec l’avancée en âge et l’éloignement du début des troubles, le risque de suicide diminue même si pour l’instant, il reste encore élevé.
Dans cette cohorte, nous avons également observé l’évolution de la médication anti-psychotique au fur et à mesure et du vieillissement des patients et de l’apparition de nouveaux médicaments. La cohorte ne répond évidemment pas à toutes les questions concernant la médication. Nous ne pouvons pas suivre cette médication au jour le jour, loin de là. Nous avons seulement effectué des coupes transversales, répétées tous les trois ans. En effet, nous avons considéré que les secteurs qui font ce travail bénévolement et qui ont de plus en plus de difficultés matérielles pour faire leur travail clinique ne pouvaient pas consacrer plus de temps à cette recherche. Cela nous permet néanmoins de suivre l’évolution de la médication, et en particulier l’arrivée des nouveaux anti-psychotiques qui émergent vraiment depuis 1999. Au travers de la cohorte, on peut suivre également l’évolution de certaines pathologies (comme le diabète, par exemple) en étant toutefois très prudents puisque les données ne peuvent être contrôlées. De plus, la cohorte se réduit au fil du temps. D’une part à 10 ans, on compte 430 décès. D’autre part, 22 secteurs ne participent plus à la recherche, soit 300 patients environ perdus pour la cohorte. De plus, chaque année des patients ne sont plus suivis, au moins au moment du renouvellement des données. Il s’agit environ d’un patient sur trois. Sur ces patients perdus de vue, par définition, on ne peut actualiser leur état de santé. En revanche, on peut rechercher s’ils sont vivants ou décédés et donc concernant la mortalité qui est notre thème premier, ces perdus de vue ne nous handicapent pas vraiment. Lorsque nous apprenons qu’un patient perdu de vue est décédé, nous en informons le secteur concerné. La cohorte offre une particularité, à savoir, qu’elle est anonyme. Nous n’avons pas le nom et le prénom des patients, seulement son année de naissance, ceci pour respecter le souci des psychiatres quant à la protection de l’identité de leurs patients. Nous avons donc mis au point une procédure particulière qui fait que ce sont les psychiatres qui envoient l’identité de leur patient à la mairie de naissance. Le problème vient quelquefois d’une connaissance très approximative par le secteur des données d’identité nécessaires. Dans l’ensemble, il y a néanmoins peu de décès non retrouvés. L’autre difficulté tient à ce que, tout comme en population générale, mais de façon plus fréquente quand il s’agit de ces patients, un certain nombre de causes restent imprécises ou non spécifiées. C’est le cas par exemple après le passage à l’institut médico-légal, dans le cas de suicides, si l’institut ne fait pas parvenir à temps la cause du décès pour l’enregistrement à l’INSEE. C’est encore le cas pour une mort naturelle mais inexpliquée qui ne donne pas lieu à autopsie. Parallèlement à l’exploitation des causes de décès du fichier national, nous demandons au secteur ce qu’il sait du décès de son patient. Cela réduit les incertitudes surtout pour les cas de suicide, qui sont le plus souvent connus du secteur.
Parallèlement à cette cohorte, nous avons mené d’autres études, maintenant dans le cadre de l’Unité 513 (Psychiatrie et Neurobiologie), dirigée par Bruno Giros. Certaines de ces études concernent le suicide. Alain Philippe est considéré comme un spécialiste dans ce domaine. Je viens moi-même d’exercer un mandat comme présidente du Groupe d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS). Notre dernière étude porte sur le suicide des personnes âgées à domicile et en maison de retraite. Le suicide des personnes âgées suscite relativement peu d’intérêt alors qu’il est beaucoup plus fréquent que le suicide des jeunes. Lorsqu’un jeune de 20 ans se suicide, il y a au moins 6 personnes de 70 ans et plus qui se suicident. L’étude montre l’importance du suicide en maison de retraite, et le risque particulier pour les femmes de 65-74 ans.
On a aussi participé à des recherches avec François Chapireau sur Handicap Incapacité, Déficience ; nous sommes en train de faire un article.
PLR – Quels sont les 3 principaux événements qui vous ont marquée ?
Ce n’est pas en terme d’évènements mais d’évolution des mentalités que je souhaite vous répondre. Certainement, une plus grande ouverture des psychiatres à la quantification. Il y a 30 ans, parler de chiffres était incongru en psychiatrie, très mal toléré. C’est quelque chose qui a complètement disparu. Aujourd’hui, les psychiatres se sont, non seulement ouverts sur ce monde là, mais ils sont très demandeurs de recherches.
Le tabou concernant certaines maladies mentales s’est effacé, comme par exemple pour la dépression. Il y a trente ans, on cachait tout autant la dépression d’un membre dans une famille qu’un siècle auparavant on cachait les cas de tuberculose. C’était vécu comme une véritable dépréciation autant du sujet que de sa famille. Bien sûr, le tabou reste pour les psychoses. Les tabous ne commencent vraiment à disparaître que lorsque l’espoir de guérison s’installe.
PLR – Vous êtes très optimiste.
Quand on a voulu faire la recherche avec Serge Lebovici sur la mortalité, vu l’agressivité déclenchée par la démarche, je ne pouvais pas imaginer que 122 secteurs accepteraient de collaborer et que 10 ans après une centaine d’entre eux continueraient à le faire. C’est quand même un critère. Oui, je suis optimiste.
PLR – N’est-ce pas une question d’âge des praticiens ?
Même pas, c’est une question de curiosité d’esprit. Bien sûr, on peut espérer que les formations des jeunes sont aujourd’hui mieux orientées vers les objectifs de recherche mais dans la cohorte par exemple, un certain nombre de cliniciens qui se sont engagés sont aujourd’hui partis en retraite. Ils étaient donc déjà d’un certain âge lorsqu’ils ont accepté d’y participer.
PLR – Quelles sont les retombées de la recherche ?
Concernant la recherche sur la mortalité des patients schizophrènes, s’il y a une retombée envisageable c’est d’attirer l’attention sur le fait que ces patients ne sont pas seulement vulnérables sur le plan psychique, mais aussi sur le plan somatique. C’est contraire à l’idée qui prévalait il y a encore 20 ans, selon laquelle ces patients étaient quasi invulnérables sur le plan somatique. Il n’est pas question de demander aux psychiatres de devenir médecins somaticiens, mais le psychiatre est quand même l’interlocuteur privilégié de ces patients et c’est lui qui sera toujours la charnière de leur prise en charge. Attirer l’attention sur le fait qu’ils ont une vulnérabilité somatique importante et qu’elle est d’autant plus importante qu’ils sont soumis à une polymédication au long court, c’est certainement une retombée positive de ce genre d’études.
Au delà de ce premier aspect, cette cohorte a permis de mettre en évidence certains facteurs de risque - ou des moments de risque - pour le patient, par exemple en ce qui concerne le suicide. Certes, il est apparu que toutes les échelles d’intentions suicidaires se heurtent à des faux positifs en si grand nombre que cela les rend inopérantes car le suicide est un phénomène rare. Néanmoins, même en sachant l’incertitude du pronostic, le psychiatre doit avoir des points de repère dans la tête. Un patient en début de maladie qui est, de plus, confronté à des évènements adverses par exemple, ne pas pouvoir continuer ses études, ne pas avoir de relation amoureuse etc., se trouve dans une situation à risque d’en finir.
Parmi d’autres retombées, je pense au diabète par exemple, avec le suivi des effets des antipsychotiques. Y a t-il une vulnérabilité au diabète de type 2 à travers une obésité favorisée par la médication ou pas ? Nous étudions cet aspect actuellement.
PLR - Comment avez-vous géré les problèmes d’organisation et de coordination, le suivi dans le temps, le débat d’idées qui accompagne le travail sur le terrain ?
Ce que nous avons toujours fait avec cette recherche, c’est d’envoyer un rapport annuel des résultats à tous les cliniciens ayant participé à la recherche, mais aussi aux secrétaires dont la participation à la recherche a été particulièrement efficace et précieuse.
Deux ans sur trois où nous n’enregistrons que la mortalité, le recueil des données est essentiellement assuré par les secrétaires. En revanche, tous les trois ans, quand on demande en plus l’ordonnance qui est prescrite à ce moment là, c’est l’ensemble de l’équipe traitante qui doit participer. Il est essentiel d’intéresser les fournisseurs de données, notamment en leur restituant régulièrement les résultats. Lorsque j’ai annoncé que je partais en retraite, les chefs de service m’ont beaucoup remerciée d’avoir reçu tous les ans un rapport faisant le point sur l’état de la recherche et ses résultats, politique qui va être continuée par Alain Philippe.
PLR – À un moment ou à un autre, vous êtes-vous posé la question de faire l’étude en population générale ?
Non, ce n’est pas par manque d’intérêt mais les moyens dont on disposait, sauf à délirer, ne permettaient pas d’y penser. En revanche, pour les études du Centre A. Binet par exemple, nous n’avions pas de dénominateur, c’est-à-dire que nous ne savions pas qu’elle était la fréquence des évènements en population générale pour pouvoir évaluer des comparaisons. En 1970, le recensement ne nous donnait pas ces renseignements. En supposant qu’il y ait eu 20% des enfants pris en charge au centre, qui vivaient avec leur mère seule, nous étions incapable de dire si c’était une sur-représentation ou pas. J’ai donc été amenée à faire une étude à travers les écoles du XIIIème arrondissement, pour évaluer ainsi les caractéristiques des familles de la population générale.
Nous avons réalisé avec Jean-Michel Thurin une étude à partir des données recueillies par le CREDES en population générale. Ces données ne concernaient certes qu’un nombre restreint d’individus avec des diagnostics de santé mentale non contrôlables, mais il était tout de même intéressant d’aller voir en population générale, qui recevait des anti-psychotiques. D’une façon générale, beaucoup de données existantes recueillies par de grands organismes administratifs ou de recherche sont sous-exploitées. Dans l’enquête HID, si François Chapireau n’avait pas été là, il n’est pas sûr que le volet santé mentale aurait été exploité. Dans un certain nombre d’enquêtes menées par ces organismes cet aspect santé mentale pourrait d’ailleurs être plus développé. En revanche, dans les enquêtes dans lesquelles la pathologie est auto-déclarée, on court le risque - on l’a vu à travers l’enquête HID – d’avoir une inflation de diagnostics tels que la dépression. Peu de patient se déclareront schizophrènes, à fortiori si on ne leur donne jamais le diagnostic véritable de leur maladie.
JMT – Au niveau du diagnostic, on avait quand même un instrument qui passait bien en population générale, même s’il n’était pas vraiment validé. On a obtenu un certain nombre de résultats ; le CREDES a refait une deuxième lecture derrière avec des instruments validés qui est arrivée aux mêmes conclusions.
Ça c’est vrai, d’ailleurs je crois qu’ils approchent de plus en plus de cet aspect. Par exemple, ils posent maintenant des questions sur la dépendance à l’alcool à travers le questionnaire CAGE.
JMT – Il y avait d’autres domaines intéressants concernant les événements de vie, le travail, les pathologies somatiques associées. A partir de données déjà recueillies, on a travaillé pendant trois ans.
C’est ce dont tu t’es occupé en effet et encore une fois, il y a des filons qui restent à exploiter.
PLR - Vous aviez encore deux autres points qui vous ont frappée ?
Il y en a un qui est négatif : c’est le non recrutement depuis des années de chercheurs dans le domaine dont nous parlons. Or ce domaine relève de la santé publique et donc des tutelles étatiques. Ce ne sont pas les laboratoires qui vont prendre le relais. À l’INSERM, travailler en santé mentale ne favorise pas vraiment une carrière. Le recrutement par la Commission d’Interface de Guillaume Vaiva pour une période de 5 ans à mi-temps, sur un thème se rapportant aux conduites suicidaires et à leur impact sur l’entourage m’a fait particulièrement plaisir.
Un point positif a été la création de la Fédération Française de Psychiatrie. Parler d’une seule voix aux autorités de tutelles, ce qui n’empêche pas des tendances internes différentes, est une condition indispensable pour avoir du poids. A-t-elle vraiment rempli cette mission ? Peut-être pas encore tout à fait. Je crois que la FFP à encore du travail à faire pour se faire entendre. La santé mentale est quand même un des premiers budgets de la santé. C’est un nombre de patients considérable à des degrés divers de souffrance et de troubles. C’est néanmoins le domaine qui compte le moins de chercheurs.
PLR – À la lumière de votre expérience sur la psychiatrie et la santé mentale quelles voies de développement concevez-vous pour la recherche dans ce domaine ?
Outre les domaines nouveaux comme la génétique, l’imagerie cérébrale etc., qui doivent continuer a être développés, le recrutement de chercheurs en santé mentale et psychiatrie est indispensable. De plus, actuellement, par manque de chercheurs ou d’ingénieurs, je le répète, de nombreuses données existantes ne sont pas exploitées.
La plupart des cohortes, notamment à l’INSERM, ont des acronymes « gazel, vespa, etc. ». La cohorte de patients schizophrènes dont j’ai parlé n’en a aucun. On l’appelle la cohorte, c’est dire qu’elle n’a pas beaucoup de concurrentes. Pourtant, il serait souhaitable qu’il y en ait d’autres comme une cohorte incidente par exemple, c’est-à-dire portant sur de nouveaux cas, en gardant à l’esprit qu’il faut au chercheur de 10 à 20 ans devant lui !
PLR – La génétique et le neuro-développemental sont des orientations actuellement favorisées. Est-ce la voie de l’avenir ? Doit-elle se faire aux dépens d’une approche plus clinique qui semble un peu abandonnée ?
Je pense en effet qu’elle est abandonnée pour partie, mais que pour autant il ne faut pas non plus diminuer l’effort sur les autres disciplines. On ne peut pas en faire l’économie. Contrairement à ce qu’ont pu penser les généticiens à un moment, ils vont mettre des années à comprendre la schizophrénie, vu l’apparente multiplicité des gènes impliqués. Parallèlement, on voit ré-apparaître d’ailleurs le rôle de l’environnement, gommé il y a encore quelques années.
L’autre jour, on nous présentait, en imagerie cérébrale, des cerveaux d’autistes. Parmi eux, trois avaient des parties du cerveau complètement « blanches » ; les cerveaux des deux autres, non moins autistes, ne présentaient pas d’anomalies particulières. C’est dire qu’il faut recueillir encore beaucoup de données pour y voir plus clair.
PLR – Quelle est votre opinion à propos de l’impact factor ? N’a-t-il pas un effet déterminant sur les orientations de recherche ?
C’est tout à fait vrai, je crois que tout le monde en a conscience, mais personne ne sait comment s’en sortir. Il faut bien trouver un moyen d’évaluation et on peut penser que celui là en vaut un autre. A l’heure actuelle, vous êtes évalué, à l’INSERM sur l’impact factor de vos études. Une étude qui paraît en français, a peu de valeur. Combien y a-t-il de revues françaises qui sont indexées à part L’Encéphale ?
Un problème plus ennuyeux, me semble-t-il, ce sont Ies modes en matière scientifique et là, iI y a un effet pervers du système.
Je crois qu’à côté des critères d’évaluations classiques pourraient exister d’autres éléments, comme l’impact d’études sur les professionnels nationaux.
PLR - Quels seraient les moyens pour y arriver ?
Je crois qu’il faut prendre conscience du pouvoir, dans le bon sens du terme, que le regroupement de sociétés savantes en psychiatrie peut exercer. Encore une fois, le domaine de la santé mentale représente beaucoup de monde et beaucoup d’argent.
PLR - Quelle place faites-vous aux relations internationales ?
Je crois que nous avons encore un effort à faire dans ce domaine. Que cela nous plaise ou non, la quasi totalité des grandes études est publiée en anglais et les grands congrès sont anglophones. Toutefois, quand ces congrès ont lieu en France, il me semble que la moindre des choses est qu’ils soient bilingues. Il n’est pas nécessaire non plus de tomber dans l’excès inverse. On peut espérer que les jeunes générations seront mieux formées pour parler anglais. Pour ma génération, il s’agissait d’apprendre la littérature et la civilisation anglaise. Vous deviez connaître Lord Byron plutôt que savoir demander un ticket de métro. Souhaitons que les échanges de chercheurs entre pays soient plus fréquents. Le nombre de chercheurs français en psychiatrie pouvant entretenir des contacts réguliers avec des collègues étrangers est trop peu nombreux. On est très absents, dans le domaine dont on parle, de la scène internationale.
PLR – vous êtes allée aux congrès, vous connaissez les étrangers et vous êtes connue.
Vous êtes gentil, mais peut-être pas autant que ça et sans doute pas suffisamment même si le travail sur la cohorte a obtenu un prix lors du derniers congrès international d’épidémiologie psychiatrique (IFPE, International Federation of Psychiatric Epidemiology). Si j’avais été parfaitement bilingue, j’aurais certainement mené une autre carrière.
PLR – Que pensez-vous d’un institut de recherche annoncé dans le plan de la santé mentale ?
J’en pense grand bien. L’autre jour, Bruno Giros disait que les pistes étaient probablement de repenser complètement l’INSERM et le CNRS qui sont des organismes lourds et donc de les repenser sous forme de GIA, GIP, etc. Peut-être y a t-il des formules plus souples, par branches, un pôle cancer, etc. Il faudrait repenser les problèmes avec un plan d’ensemble. Toutefois, il ne serait pas bon que le travail s’arrête en attendant.
PLR – Avez-vous eu le sentiment d’avoir été déconsidérée par vos collègues chercheurs des autres disciplines ?
Il y eu une période où tout ce qui était psychiatrie était considéré comme science molle puisque ne répondant pas à des analyses et autres examens de laboratoires, aux résultats en principe incontestables. Même si cette attitude n’a pas complètement disparu, elle n’est plus aussi virulente. Tout un chacun est amené à reconnaître que, science molle ou pas, les patients en psychiatrie sont une réalité. Le travail sur la cohorte n’a jamais donné lieu à contestation. Un autre aspect a contribué aussi à revaloriser l’aspect de la psychiatrie. C’est que les somaticiens eux-mêmes se sont rendu compte que leurs objets d’études n’étaient pas toujours parfaitement définis. Plus on avance dans la recherche, plus on devient modeste, du moins si l’on est quelqu’un de normal.
PLR – Avez vous un avis sur l’entreprise PMSI ?
Un avis autorisé, je n’en ai pas.
Être contre le PMSI par principe ne signifie rien et ce n’est pas moi qui vais m’élever contre un recueil systématique de données. Le tout est qu’il soit pertinent et il n’est pas sûr d’après les échos que j’ai pu en avoir qu’il soit au point et pas seulement pour la psychiatrie. L’INSERM a mis au point, dans un tout autre domaine, depuis un an, un logiciel dénommé « saphir ». Depuis cette date, c’est la pagaïe dans l’administration. Il aurait été utile, à l’évidence, de tester davantage avant de le mettre sur le marché ou de le retirer rapidement pour le repenser avant de le relancer.
La surmortalité des malades mentaux dans les siècles passés était essentiellement provoquée par les maladies infectieuses, facilitées par la concentration asilaire et l’absence de traitement médicamenteux. Depuis 50 ans, on observe une surmortalité par suicide mais les causes naturelles sont aussi sur-représentées. C’est ce que nous enseignent les études étrangères car en France, ce sujet a été très peu étudié. Chose est maintenant faite grâce à Françoise Casadebaig et Alain Philippe, chercheurs INSERM dans l’unité 513, dirigée par Bruno Giros. Depuis 1993, ils ont mené une étude prospective sur une population de patients schizophrènes. Cette recherche, à laquelle participent 122 secteurs psychiatriques est soutenue par la Direction Générale de la Santé et la Fondation pour la Recherche Médicale. Elle a reçu en 2002 un prix de l’International Federation of Psychiatric Epidemiology. Elle est, à notre connaissance, la seule étude de cette ampleur en France, sur le thème de la mortalité et de la morbidité des schizophrènes.
3470 patients ont été inclus dans cette enquête, suivis dans 122 secteurs de psychiatrie volontaires pour participer à cette étude, répartis dans 69 départements, plus un secteur de l’Ile de la Réunion. En 1993, des données socio-démographiques pour chaque patient ont été recueillies et tous les trois ans, des données médicales sont réactualisées. Chaque année, il est vérifié auprès des secteurs si le patient est vivant, perdu de vue ou décédé.
Les résultats présentés ici concernent la cohorte de patients avec 9 ans de suivi. 542 sujets ont été perdus de vue du fait de l’abandon de 21 secteurs. La raison majeure pour le retrait de ces secteurs de l’étude est dûe à la rotation professionnelle des médecins. En réalité, il y a eu beaucoup plus de mutations que la vingtaine de secteur manquants, mais dans la majorité des cas, la recherche a été reprise par quelqu’un d’autre du secteur.
« Pour les patients suivis régulièrement pendant 9 ans dans les mêmes secteurs soit environ les deux tiers d’entre eux, on note une diminution d’un certain nombre de comportements à risque comme les tentatives de suicide, l’alcoolisme ou la consommation de drogues illicites. A l’inverse, la consommation de tabac de plus de 20 cigarettes/jour touche deux fois plus de patients en 2002 qu’en 1993, passant de 1 patient sur six à un patient sur trois. La proportion de patients obèses passe de 14 à 17%.
L’importance de la mortalité prématurée chez les patients schizophrènes est à nouveau mise en évidence par cette recherche. Toutes causes de décès confondues, à sexe et âge comparables, la mortalité est près de 4 fois plus élevée chez les patients. Les facteurs de risque de mortalité prématurée traditionnellement retrouvés en population générale comme le sexe masculin, le mode de vie seul, n’être pas marié, les addictions ou les comportements suicidaires se retrouvent chez les patients schizophrènes. Ces risques sont par contre plus accusés chez eux. Par exemple, à état matrimonial semblable le risque de mortalité est 2,6 plus élevé pour les patients schizophrènes.
Le suicide représente dans cette cohorte comme dans la majorité des études la première cause de décès. C’est en début de maladie que le suicide apparaît comme un risque majeur [Brown 1997]. Avec la sélection des patients (les plus à risque sont déjà décédés), le vieillissement, l’éloignement du début de la maladie et un suivi régulier, les taux de suicide diminuent très nettement. A l’exception de l’âge, les autres facteurs de risque sont semblables aux risques mis en évidence en population générale (masculinité, addictions, tentatives de suicide antérieures). Une différence toutefois, c’est que l’alcool n’est pas retenu par l’analyse multivariée comme facteur spécifique de risque de suicide alors qu’en population générale, l’alcool est associé au passage à l’acte. La pendaison, tout comme en population générale est le mode le plus fréquemment utilisé [Casadebaig et al 2002]. Le suicide, s’il est beaucoup plus fréquent chez les patients schizophrènes reste néanmoins au niveau d’un service, un événement rare et donc d’autant plus imprévisible.
La mortalité par cancer des schizophrènes fait depuis longtemps l’objet d’un débat. Les données les plus riches sur ce sujet sont venues de l’observation du registre danois des schizophrènes [Mortensen1989]. Les chercheurs ont observé moins de cancers des voies respiratoires, moins de cancers de la prostate, moins de cancers des organes génitaux chez les femmes mais une tendance à plus de cancers digestifs et plus de cancer du sein chez les femmes. Les observations pour les femmes sont conformes à ce que l’on connaît en population générale, à savoir moins de cancer des organes génitaux et plus de cancers du sein chez les femmes ayant moins d’enfants, ce qui est le cas des femmes schizophrènes ».
Cependant, « une étude finlandaise récente portant sur 26 996 patients schizophrènes suivis pendant vingt cinq ans et pour lesquels on a pu procéder à un croisement avec les données du fichier du cancer a montré un risque de cancer accru chez les patients surtout pour le cancer du poumon et du pharynx ; ce risque ne se retrouvait pas chez les parents et les frères et sœurs des patients et pouvait être attribué à certains comportements à risque des patients comme la consommation d’alcool et de tabac [Lichtermann et al 2001]. Les résultats de la cohorte française semblent aller dans ce sens. La comparaison, dans la cohorte, des patients décédés par cancer du poumon avec des témoins appariés par sexe et âge, ne met en évidence qu’une seule différence : la consommation de tabac ».
Concernant, « l’évolution de la médication antipsychotique sur des patients schizophrènes, telle qu’elle apparaît à travers cette étude », elle « va dans le sens des recommandations de la conférence de consensus de 1994 [...]. Conformément aux recommandations de cette conférence, on observe un nombre croissant de patients sous monothérapie. La prescription sort toutefois des recommandations de la conférence pour 5% des patients qui, en 2002, reçoivent trois antipsychotiques ou plus. Globalement, on constate aussi une assez grande stabilité des prescriptions et le facteur le plus prédictif de recevoir tel ou tel médicament est de l’avoir eu avant. Il est évident que lorsqu’un patient est stabilisé, le psychiatre hésite à modifier l’ordonnance ». Toutefois, en 2002, 33% de patients reçoivent des anti-psychotiques atypiques.
Quelques références bibliographiques
Brown, S. Excess mortality in schizophrenia. A meta-analysis. Br. J. Psychiatry, 1997 ; 171 (12) : 502-508.
Casadebaig F, Philippe A, Lecomte Th, Gausset MF, Quemada N, Guillaud Bataille JM, Terra JL. Etat somatique et accès aux soins de patients schizophrènes en secteurs de psychiatrie générale. L’Information psychiatrique, 1995 ; 3 : 267-271.
Casadebaig F, Philippe A, Guillaud-Bataille JM, Gausset MF, Quemada N, Terra JL. Schizophrenic patients : physical health and access to somatic care. Eur. Psychiatry, 1997 ; 12 : 289-293.
Casadebaig F, Philippe A, Fievet Mh. La prescription de psychotropes chez 3460 patients schizophrènes suivis en secteurs psychiatriques en 1993. La Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, 1998 ; 15 : 74-78.
Casadebaig F, Philippe A. Mortalité chez des patients schizophrènes: trois ans de suivi d’une cohorte. L’Encephale, 1999 ; 25 : 329-337.
Casadebaig F, Philippe A. Mortalité par suicide dans une cohorte de patients schizophrènes. Ann. Med.-Psychol., 1999 ; 157,8 : 544-551.
Casadebaig F, Ruffin D, Philippe A. Le suicide des personnes âgées à domicile et en maison de retraite en France. Rev. Epidemiol Santé Publique, 2003 ; 51 : 55-64.
Mortensen PB. The incidence of cancer in schizophrenic patients. J. Epidemiol Community Health, 1989 ; 43 : 43-47.
Lichtermann D, Ekelund J, Pukkala E, Tanskanen A, Lönnqvist J. Incidence of cancer among persons with schizo-phrenia and their relatives. Arch. Gen. Psychiatry, 2001 ; 58 (6) : 573-580.
Montout C, Casadebaig F, Lagnaoui R, Verdoux H, Philippe A, Begaud B, Moore N. Neuroleptics and mortality in schizophrenia : prospective analysis of deaths in a french cohort of schizophrenic patients. Schizophrenia Research, 2002 ; 57 : 147-156.
Conférence de consensus. Stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses schizophréniques, Paris, Frison Roche, 1994.
Glickman J, Pazart L, Casadebaig F, Philippe A, Lachaux B, Kovess V, Cochet-Faurisson C, Terra Jl, Durocher A. Étude de l’impact de la Conférence de Consensus « Stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses schizophréniques ». L’Encéphale, 1999 ; XXV : 558-68..
Ont collaboré à cet ouvrage : O. Canceil, J. Cottraux, B. Falissard, M. Flament, J. Miermont, J. Swendsen, M. Teherani, JM. Thurin
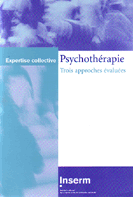 Cette expertise collective est réalisée sous l’égide de l’Inserm à la demande conjointe de la Direction Générale de la Santé et de deux associations de patients, l’Unafam et la Fnap-psy. Elle dresse un état des lieux de la littérature internationale sur l’évaluation de l’efficacité de trois approches psychothérapiques : psychodynamique (psychanalytique), cognitivo-comportementale, familiale et de couple.
Cette expertise collective est réalisée sous l’égide de l’Inserm à la demande conjointe de la Direction Générale de la Santé et de deux associations de patients, l’Unafam et la Fnap-psy. Elle dresse un état des lieux de la littérature internationale sur l’évaluation de l’efficacité de trois approches psychothérapiques : psychodynamique (psychanalytique), cognitivo-comportementale, familiale et de couple.
Mots clés : évaluation psychothérapie, psychodynamique, psychanalytique, cognitivo-comportementale, familiale et de couple
* Éditions Inserm, ISBN 2-85598-831-4, 568 pages, Février 2004
Au cours de la conférence de presse de présentation de l’expertise (26/02/2004), William Dab, Directeur Général de la Santé a notamment précisé six points :
- La direction générale de la santé avait demandé à l’Inserm de réaliser cette expertise collective dès 2001, bien avant le déluge de commentaires ayant accompagné les discussions parlementaires de l’amendement Accoyer visant à encadrer l’exercice des psychothérapies.
- L’Inserm n’a pas réalisé un travail de « marketing scientifique » comme certains l’ont dit, mais une expertise approfondie, multi dis ciplinaire et contradictoire, probablement la plus difficile des expertises collectives menées par l’Inserm. Cependant, ce n’est qu’une première étape dans l’évaluation du service rendu par les psychothérapies.
- Il serait réducteur d’en conclure que les thérapies comportementales et cognitives ont définitivement fait la preuve de leur supériorité sur les autres psychothérapies. C’est un contre-sens. Et c’est un piège dans lequel nous ne tomberons pas.
- Certains regrettent que cette expertise soit presque exclusivement basée sur l’analyse de publications anglo-saxonnes qui ne reflètent guère la réalité des pratiques hexagonales. Je ne puis que le regretter à mon tour, même s’il y a quelques excellentes contributions françaises parmi les mille publications analysées dans ce rapport.
- On peut attendre dans un pays qui compte 13 000 psychiatres, des dizaines de milliers de psychologues et de psychothérapeutes, des très nombreux psychanalystes, qu’il soit un des leaders de la recherche en santé mentale. Nous souhaitons donc encourager la connaissance de l’évaluation de ces activités.
- Le refus de la démarche évaluative est une attitude qui n’est ni scientifique, ni éthique. Il faut le dire très haut.
Subventions pour des projets collaboratifs
associant des cliniciens et des chercheurs
Date limite de dépôt des dossiers d’intention : 9 avril 2004
Contact : Solange Guenez ; Fax : 01 44 21 31 97
E-mail : recherche@fdf.org
Dossiers de candidature et appels d’offres à télécharger : www.fdf.org “espace chercheurs”
Dernière mise à jour : 5 avril 2004 16:18:38
| Accueil PLR | |