Il
serait intéressant que les différentes sciences humaines soient au
minimum évoquées dans les formations. Travailler sur le
psychisme, donc sur une part essentielle de l’homme, suppose à la
fois des connaissances techniques, mais un recul, voire une sagesse (pour ceux
qui y arrivent) permise par l’ouverture vers d’autres cultures
quelles qu’elles soient.
Les
réponses monocolores, standardisées, en série,
pré-programmées, même si elles sont quelquefois
nécessaires, ne résistent pas longtemps en face d’une
réponse plus recomposée, de ce fait plus humaine, des diverses
approches.
« La société française a
besoin pour ses psychiatres de bien plus de polyvalence que de formation
mono-disciplinaire et univoque…Il ne s’agit pas de plus de diplômes
mais de plus de formation[1] ».
Au fil de leur formation médicale puis de leur
spécialisation ils devraient, selon nous, d’abord avoir des bases
solides dans les 3 domaines « bio-psychologique-social »
et ensuite pouvoir approfondir leur formation dans une, deux ou les trois directions
selon leur inclinaison personnelle et leur choix de carrière.
Les psychiatres en formation doivent, à
l’avenir, beaucoup plus « tourner » dans les
secteurs de psychiatrie et ne plus être d'une certaine manière
"réservés" à l'usage quasi exclusif de services
universitaires qui sont de fait en situation de monopole, étant juges et
partis.
De même il est souhaitable de
déspécifier la formation des psychiatres à
l’intérieur de leur spécialité : tous les
psychiatres devraient être formés à la psychiatrie de l’enfant
et des différents âges de l’homme.
Une nécessaire adaptation du chiffre du
"Numerus Clausus" pour garder les effectifs à leur niveau
actuel doit être programmée. On peut également envisager
une sorte de contrat de service public, pour 5 ans, dans la zone où l'on
effectue son internat.
Cet enrichissement, conforté par une
réorganisation en profondeur des formations continues agrées et
contrôlées par les organismes publics, les orienterait alors vers
des pratiques et des responsabilités différentes.
Un enseignement complémentaire est
indispensable en santé publique ainsi que pour l’animation
d’équipe.
Un aménagement de la formation initiale des
psychologues est indispensable au niveau de l’organisation des stages, de
leur contenue et de leur validation.
La meilleure intégration et la meilleure
formation hospitalière des psychologues sont sans doute des voies
à explorer. A noter l’expérience de l’Espagne,
où existe un internat en psychologie sur concours, avec exercice
hospitalier pendant deux ans, préparant
aux carrières de psychologue clinicien.
Reste le problème du 1/3 temps de
formation : soit il est étendu à tous les professionnels,
soit il est supprimé pour cette catégorie professionnelle. D'une part dans un souci d'équité,
d'autre part parce que le temps de formation-recherche est un besoin pour
toutes les catégories professionnelles.
Un
enseignement complémentaire est indispensable en santé publique.
La pratique
publique et/ou « libérale » serait bien entendue
possible mais donnant lieu à un conventionnement spécifique. Il
est indispensable que, pour actes thérapeutiques, les personnes soient
adressées aux psychologues par un psychiatre, afin
d’écarter au préalable les affections somatiques à expression
psycho-comportementale et afin de faire bénéficier les patients
d’un remboursement par la sécurité sociale, ce qui
étendrait l’accès à ce type de thérapeutique.
La
formation initiale, insuffisante en psychiatrie, doit être à tout
prix garantie car ce sont les infirmiers DE qui, dans leurs différents
lieux d’exercice, sont et seront bien souvent en première ligne
face aux troubles psychiques. Comment, au delà du Diplôme
d’Etat et pour les infirmiers qui travaillent en secteur de psychiatrie,
apporter des formations nécessaires qui ne soient pas trop
hospitalo-centriques ni livresques ? Nous pensons que cette formation au
diplôme d’infirmier DE devrait être intégrée
dans le corpus des enseignements universitaires (en faculté de médecine par exemple).
Il serait souhaitable d’y adjoindre une réflexion sur
les représentations sociales, le travail individuel avec un patient, les
pratiques ambulatoires, les psychothérapies, le lien avec la
communauté etc.
Faut-il en passer par une spécialisation ou bien faire assurer
ceci par les organismes de formations continues (qui assureraient dans ce cas
une charge attribuée normalement à la formation initiale) ? Nous
pensons préférable d’organiser cette formation
supplémentaire par l’acquisition d’un certain nombre de
modules pendant que l’infirmier DE travaille dans un secteur de
psychiatrie. Une sorte de stage en
cours d’emploi qui pourrait s’organiser en 1/3 temps de cours
à la faculté et 2/3 temps dans une équipe soignante. Nous
préférons donc l’accès à une formation complémentaire
mais qui ne consiste pas en une simple année supplémentaire
à la faculté.
Le débat est posé et il dépasse
la seule corporation infirmière. Peut-on imaginer, pour l'ensemble du
système sanitaire, un autre découpage des
spécialités en, par exemple, Chirurgie, Médecine interne,
Obstétrique, Santé Mentale, Santé Publique,
Pédiatrie et la fin de la multiplication à l'infini des
sous-spécialités ?
Ce sont des innovations dans la pratique des
travailleurs sociaux, tant en direction des équipes soignantes que des
acteurs dans la communauté, que dépendra en grande partie
l’évolution globale des prises en charge en santé mentale.
Une plus grande mobilité, une plus grande responsabilité leur
seront demandées et ils participeront au travail dans les réseaux
dans une dynamique d’aide et d’accompagnement des personnes et dans
celle d’articuler les dispositifs les uns aux autres.
Pour eux
aussi, des enseignements complémentaires en cours d’emploi sont
nécessaires.
Nous pensons qu’une formation conjointe à
la santé mentale et au travail social devrait être
organisée pour l’ensemble des filières, ce qui permettrait
de limiter les incompréhensions et de favoriser l’articulation
entre champ sanitaire et social.
Les professionnels de ces deux champs devraient
pouvoir diversifier leurs connaissances (les nouvelles fonctions) en
renforçant leurs compétences dans différentes directions
et également, s’ils en expriment la volonté, accéder
à une formation supplémentaire (avec stages) dans les domaines
psychiatrique et/ou social.
Dans le cas de l’acquisition d’une
compétence en psychothérapie, la pratique publique et/ou
« libérale » serait bien entendue possible donnant
lieu à un conventionnement spécifique, dans des conditions
comparables à celles des psychologues.
Eux aussi se trouvent
devant la nécessité de repenser leur formation, leurs objectifs
et leur rôle respectif dans la perspective de l’évolution de
la psychiatrie vers le champ de la santé mentale dans les années
à venir. En effet, ils seront tout naturellement impliqués dans
les futures actions de soin et
d’insertion :
Pour les uns dans les
stratégies à mettre en place pour l’accès au
travail, que se soit en milieu protégé ou même en milieu
ordinaire.
Pour les autres dans des
stratégies à mettre en place, dans la communauté,
notamment pour l’amélioration des capacités
d’autonomisation.
On comprend que les
techniques psychothérapiques doivent être assujetties à une
formation spécifique. L’accès à cette formation doit
être possible pour d’autres professionnels que les seuls
psychiatres, psychologues cliniciens et infirmiers (sociologues, philosophes…)
qui, jusqu’à maintenant, «s’autorisent
d’eux-mêmes et de quelques autres » comme le disait J.
Lacan au sujet des psychanalystes. Ce cursus de psychothérapeute devrait
être sérieusement encadré et validé par
l’université ou des écoles agréées.
Le débat et la
réflexion sur ce sujet sont en cours au niveau national.
Pour certains
professionnels, l’accès à la compétence en
psychothérapie devrait être accessible à d’autres professionnels, par un
système d’équivalences, en passant par les seules
formations (revisitées comme évoqué ci-dessus) de
psychologue ou de psychiatre. Autrement dit pour être
psychothérapeute il faudrait, selon eux, être soit psychiatre soit
psychologue (c’est-à-dire avoir satisfait à un cursus
universitaire garantissant la formation). D’autres pensent à un
cursus autonome.
Quelle que soit la
formule nous pensons que cette compétence doit être ouverte
à des personnes d’origines professionnelles diverses. Toutes les
techniques devront être validées et évaluées par
l’ANAES.
Les compétences
et les fonctions des secrétaires médicales évoluent. Dans
la nouvelle organisation des soins elles seront la cheville ouvrière de
la circulation d’informations dans les réseaux. Elles devraient
avoir, comme les autres professionnels, après formation adaptée,
accès aux nouvelles fonctions en santé mentale.
La future réforme
du 3ème cycle des études médicales devrait
obligatoirement intégrer un semestre obligatoire en secteur de
santé mentale, qu’il
est souhaitable d’organiser au sein des équipes de soins
ambulatoires et plus particulièrement dans le travail en réseau
avec les champs sanitaires somatiques et les champs médico-sociaux et
sociaux.
La formation des personnels administratifs de direction
d’établissement bénéficierait également
d’un approfondissement dans le domaine de la santé publique et de la santé mentale, de stages dans les
services de soins organisés spécifiquement pour eux. Ceci
faciliterait peut-être les passages de la direction
d’établissement somatique à celle des nouveaux STP et
inversement avec des compétences élargies mais surtout ceci
devrait permettre à certains de moduler une vision parfois trop
centrée sur la gestion administrative et comptable des équipes et
des structures sous leur responsabilité.
Les familles d’accueil sont des personnes qui acceptent de vivre
avec des semblables ayant des troubles mentaux. Alternative forte à
l’hospitalisation (utilisée comme hébergement), il conviendrait de
leur donner, une formation adaptée, un statut adéquat et de les
valoriser.
L’enseignement supérieur en France reste très
cloisonné, avec très peu de passerelles, ce qui conduit un
certain nombre d’étudiants dans des impasses.
Pourquoi ne pas imaginer un tronc commun sanitaire ou sanitaire et
social, pour les études de médecine, d’infirmier,
d’éducateurs. Avec,
s’il existait toujours un numerus clausus en médecine, un
positionnement après ce tronc commun ?
Des formations complémentaires dans le domaine de la santé mentale et de la
santé publique, devraient être accessibles à tous les
professionnels. Ces formations pourraient être dispensées par
l’Ecole Nationale de santé Publique, sous réserve que cette
école soit réformée, c'est-à-dire développe
des compétences élargies bien au-delà de la gestion
(Infirmiers Généraux et directeurs).
Il faudrait mettre en place des compétences permettant d'assumer
et de développer des missions de santé publique, de garant de la
qualité des soins, pour reconnaître les compétences
d’ «opérateurs en santé
mentale »,
d’ «ingénieurs réseaux »
… que certains d’entre eux montrent depuis longtemps sur le
terrain. Cela pose bien sûr le problème des profils des formateurs
de cette école.
Des stages de 1 à 3 mois en secteur de santé mentale, par échange de poste autant que possible,
devraient être organisés, tous les 5 ans au moins. Nous
serions tous visiteurs critiques et visités critiqués. Cela
pourrait être inclus dans la formation continue et les échanges
pourraient être une véritable bibliothèque d'idées
et de pratiques, ainsi qu'une bourse d'expériences qui permettraient de
voir se répéter les innovations et les créations
pertinentes de la sectorisation bien comprise.
Des formations donnant accès à de nouvelles fonctions
ou des postes plus qualifiés
:
§
développeur
d’actions auprès des usagers,
§
ingénieurs
réseaux santé mentale,
§
agents
d’intégration culturelle et artistique (il faut absolument
souligner que les artistes manifestent depuis toujours une qualité
d’accueil, d’écoute et d’intégration à
la vie sociale. Il doivent faire partie des acteurs sociaux partenaires des STP
et des RTSM et être rétribués en fonction).
Ces professionnels exerceraient de façon
transversale dans le cadre des réseaux au niveau des secteurs, des
bassins de santé, des départements et des régions dans les
sphères sanitaires, sociales et médico-sociales.
De même
les responsables-qualité actuels, tout à fait nécessaires et qui devraient être
valorisés, devront étendre leurs actions aux bassins de
santé.
Nous proposons la création, dans tous les
RTSM, de départements de recherche médicale qui intègrent les personnels volontaires des secteurs, la médecine
«libérale», les acteurs sociaux et dans certains cas les
usagers, dans des politiques de recherche. Il s'agit aussi de ne pas oublier
les recherches cliniques (et pas uniquement pour des patients
hospitalisés) mais aussi sur les représentations sociales, la
dynamique des groupes etc., sans limitation à quelque champ de recherche
que ce soit.
Une
aide méthodologique pourrait être fournie par des Centres Régionaux de Recherche en
Santé Mentale (CRRSM)
à tous les acteurs en santé mentale qui ont un projet de
recherche. Ces centres, fédérant l’ensemble des secteurs de
santé mentale, passeraient des conventions avec les universités
de santé, de droit, de sciences humaines et sciences sociales, ainsi
qu’avec les organismes nationaux tels l’INSERM, le CNRS, les ORS et
les Conseils Régionaux. Les 26 régions (dont 4 outre-mer)
auraient chacune un centre régional de recherche en santé
mentale, co-financé par les ARH. Cette organisation permettrait :
§
d’une part, de développer
des indicateurs fiables région par région.
§
d’autre part, d’impulser
une véritable dynamique de recherche à la fois médicale et sociale, la seule capable de
modifier les pratiques dans le cadre de recherche-actions. La participation de
professionnels d’autres champs serait recherchée, car la
santé mentale est évidemment dans tous ces domaines affaire de
spécialistes et non spécialistes, affaire de
complémentarité entre les savoirs initiés et les savoirs
profanes.
L’expérience pilote menée dans ce sens dans la
région Nord Pas-de-Calais[2]
est un exemple de ce qui peut ce faire.
Cette
proposition se rapproche des Délégations Régionales
à la Recherche Clinique (DRRC). Aussi conviendrait-il de trouver un
dispositif ou une formule qui garantisse les projets de recherche issus des
services non universitaires par :
§
des organisations fédératives
régionales pour porter et
promouvoir les projets : les CRRSM ci-dessus, éventuellement en
collaboration avec les universités et la DRRC ;
§
au niveau d’un
établissement on peut confier la coordination des projets de recherche
à un médecin (travaillant sur quelque fonction que ce soit sans
en exclure le DIM).
En 2001, pour la 1ère fois, les crédits
Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) ont 2 enveloppes :
§
projets de recherche
nationaux,
§
projets de recherche
régionaux (il doit y avoir des crédits réservés
pour des projets non universitaires).
L’idéal
serait évidemment que les financements se complètent : des financements publics (qu’il
n’y ait aucune défaillance de l’état, des
universités, des organismes de recherche) et des financements privés.
Les
essais médicamenteux devraient aussi être effectués par des
experts indépendants. Il serait judicieux de collecter depuis
l’industrie pharmaceutique des ressources permettant d’effectuer,
par le biais de l’Agence du médicament et avec des mandats précis des pouvoirs
publics, certaines études qui paraîtraient complémentaires
de celles menées dans le privé[3] .
Les molécules seraient testées dans l’ensemble du
système public et privé à partir de protocoles mis en
place par l’Agence.
Nous
souhaitons qu’une réflexion s’engage sur la place des
médicaments dans les stratégies thérapeutiques en
matière de santé mentale.
Une
revalorisation des carrières et une mise à plat des statuts
hospitaliers doit accompagner la mutation du système. L’ordonnance
instituant la multitude des statuts de praticiens travaillant dans la fonction
publique hospitalière doit être abrogée, avec, bien
entendu, des mesures transitoires pour les personnes concernées.
Nous
préconisons l’instauration d’un statut unique de
médecin de service public, avec la même échelle de salaire
et les mêmes devoirs[4].
Cela
aurait pour avantage de revaloriser l’activité clinique, et de
permettre aux praticiens de service public volontaires, d’effectuer de la
recherche ou de l’enseignement. Ce statut unique rendrait possible, par
exemple, des périodes d’exercice préférentiel comme
clinicien, d’autres périodes comme chercheur et d’autres
enfin comme enseignant, selon les compétences et inclinaisons des uns et
des autres.
Il
aurait également l’avantage de :
§ de diversifier le contenu des formations des différents professionnels,
§ de dynamiser les sujets de recherche (à la condition que leurs financements soient
réorganisés et transparents),
§ de rendre plus attractives les carrières
publiques par l’accès
facilité à une
diversité des pratiques (clinique, enseignement, recherche,
organisation et santé publique),
§ de permettre l’élaboration de
passerelles public/privé
.
La limite pour
l’accès à ce statut unique, sans passage par un concours de
médecin de service public (actuellement praticien hospitalier), serait
fixée à 20 %. Au-delà il y aurait nécessité de concours et le temps consacré
au service public pourrait aller de 100 à 30 % par périodes de
temps contractuellement fixées.
Dans
cette optique il est naturel que des compléments salariaux soient
octroyés en cas de fonctions de responsabilité dans les domaines
clinique (chef de secteur …), de recherche (responsable de projet
…), d’enseignement (responsable de département …),
d’organisation (fonction de direction médicale - et
paramédicale bien entendu - dans les STP...).
Ces
fonctions de responsabilité devraient avoir une période
limitée, par exemple 5 années, avec un maximum de 2 mandats
consécutifs.
Pour
les universitaires le statut unique serait appliqué, comme pour tous les
praticiens, en ce qui concerne leur temps de soin. Quant à leurs responsabilités et leur
statut, d'enseignement et de recherche elles ne seraient pas modifiées,
pour ceux qui sont en poste actuellement.
Par
contre il est indispensable que, dans les mêmes conditions de
rémunération et proportionnellement au temps passé,
l'accès à des fonctions d'enseignement et de recherche (sous la
forme de chargé de cours, de professeur associé…) soit
repensé au plan de ses procédures (une ouverture des commissions
de nomination à des non-universitaires devrait être
envisagée).
A terme ne faut-il
pas revoir les statuts et règles de fonctionnement universitaires pour
que les postes hiérarchiques soient, là aussi, assis sur des
mandats de 5 ans, avec un maximum de 2 mandats consécutifs ?
L’évolution, la dynamique des idées et des enseignements en
seraient certainement enrichies.
Ce statut unique, pour
la pratique en service public, permettrait de corriger le différentiel
actuel de rémunération entre les psychiatres privés et
publics qui, s’il reste trop important, resterait un obstacle aux
passerelles envisagées.
Ces
passerelles doivent être lancées afin de favoriser les pratiques
« mixtes » (public/privé,
clinique/recherche/enseignement), dans le temps et les fonctions, selon les
orientations et compétences professionnelles. Pour cela, une grille
de rémunération incitative, doit être mise en place de
façon égalitaire, afin de permettre les passages enseignement
– recherche – clinique (le mi-temps hospitalier doit être
payé au même niveau que le mi-temps universitaire)
Un
temps public de 2 demi-journées (20%) de travail pourrait alors
être demandé aux praticiens libéraux conventionnés. Ce temps, dédié au secteur
public pour la prévention et des actions de soins et de
réinsertion ou autre, ne serait pas payé à l’acte.
Il correspondrait aux 2 demi-journées (20%) d’intérêt
général (ou de privé) que peuvent actuellement effectuer
statutairement les praticiens hospitaliers, médecins de service public
à temps plein.
Dans
les zones non déficitaires la situation des praticiens hospitaliers est,
depuis la signature du protocole de mars 2000, plus satisfaisante
qu’auparavant si l’on n’exclut pas de la prime
multi-établissements les psychiatres praticiens hospitaliers (et les
autres professionnels des secteurs) actifs, inscrits nommément dans des
réseaux ayant donné lieu à agrément et
conventionnement. Le secteur de psychiatrie a fait avant les autres du
«multi-établissements» dans le social et la
communauté. Il doit maintenant bénéficier de la
reconnaissance de ce travail précurseur.
La question particulière de la participation des
professionnels de la santé mentale à des actions humanitaires
mises en place par des ONG reconnues devrait être revue tant au plan de la
durée (15 jours ne sont parfois pas réalistes pour certaines
missions) que de celui de la procédure d’autorisation interne aux
établissements.
Il faudra adapter aux besoins locaux la gestion des
postes vacants. Le système actuel a pour conséquence de fixer
dans la durée, pour près de 2 ans dans certains cas,
l’inoccupation d’un poste. Les nominations doivent toujours rester
de la compétence du Ministre, mais ne faudrait-il pas que le rythme des
commissions paritaires soit beaucoup plus fréquent ?
Pour remédier aux inégalités
(dont nous avons vu qu’elles venaient parfois d’une carence de
candidatures en personnels qualifiés plus que d’une absence de
budget), pour ne plus voir la désertification, choquante pour ne pas
dire scandaleuse en terme de santé publique et
d’équité en terme d’accès aux soins des
populations, de certaines zones du territoire national, il ne faut pas se
contenter de la prime de 65.000 F/5 ans (soit moins de 1000 F/mois),
proposée aux seuls praticiens hospitaliers.
Il faut aller vers un doublement des salaires (exemple
en Suède) pour toutes les catégories de personnels qui
s’engageraient, pour 5 ans, à travailler dans ces zones. Il s’agit le plus souvent de zones du
territoire et non pas de régions entières. Faut-il créer
des Zones où la Santé est une Priorité (ZSP) ?
L’on connaît les perspectives
d’évolution démographique de notre pays en ce qui concerne
les psychiatres publics. Si les mesures proposées ci-dessus se mettaient
en place, notre pays (le premier dans la communauté européenne
pour le nombre de psychiatre par habitant) doit, à effectif constant
pour les psychiatres, mieux répartir géographiquement et vers le
secteur public ces professionnels du public et du
« libéral ».
Il
devrait être établi, et publié, un plan national
pluriannuel de formation d’un nombre (que les évaluations
prospectives devraient préciser) supplémentaire
d’infirmiers. Le secteur public offre en France, pour les infirmiers, des
avantages financiers légèrement plus intéressants que le
privé. Mais certains établissements privés sont en train
de réagir et de proposer des avantages secondaires parfois
« alléchants ». Il n’en reste pas moins que
ces salaires ne vont pas suffire pour rendre attractif le métier
d’infirmier qui attire de moins en moins de jeunes. Une revalorisation
semble inéluctable.
En
termes d’effectifs, les disparités entre secteurs sont choquantes
et inadmissibles. Le plan que nous
proposons devra être chiffré
précisément, au niveau des STP et en tenant compte de
leurs spécificités.
Quant
aux psychologues, travailleurs sociaux et autres intervenants, une modification, négociée
paritairement, des conditions d’embauche, des conditions de travail et de
mises à disposition dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux
et sociaux doit intervenir.
Les
personnels administratifs, locaux, départementaux et régionaux, sont également concernés par cette
dynamique de changement. Ne peut-on imaginer, pour les directions
d’établissement, une incitation, qui dépasse la bonne
gestion des institutions dont ils ont la charge, en faveur de projets -
élaborés collectivement dans les établissements actuels -
de relocalisation des structures de soin dans les secteurs ?
Ne
peut-on imaginer des procédures de gestion des secteurs et des
activités de réseau plus transparentes et plus
participatives ?
Dans
le cas d’une réforme d’ensemble de ce type on peut
prévoir à terme une nouvelle répartition, qualitative et
quantitative des divers professionnels, très différente de celle
que l’on connaît actuellement. Cette nouvelle répartition
serait accentuée par la régulation administrative des lieux d’installation.
En
effet, en dehors de l’argumentation clinique envisagée plus haut,
un nombre important de psychologues cliniciens (pour certains actuellement au
chômage) pourrait se diriger vers un travail
« libéral » ainsi que certains infirmiers,
travailleurs sociaux et d’autres personnes ayant obtenu la qualification
de psychothérapeutes, (on se souviendra que près des 2/3 des
patients pris en charge par les psychiatres libéraux ne reçoivent
aucun médicament et sont suivis en psychothérapie ou
prétendue telle[5].
Dans
cette pratique « libérale », du fait de la
diversification des intervenants qualifiés évoquée
ci-dessus, on pourrait voir une diminution des effectifs des psychiatres (le
marché étant partagé entre un plus grand nombre
d’acteurs dont les tarifs seraient directement concurrentiels) et la
réorientation vers des pratiques publiques si les possibilités
statutaires étaient aménagées associé à des
conditions de travail attractives.
Les
statuts de psychothérapeute reconnus, une embauche spécifique de
ces professionnels dans les services publics pourrait être
organisée ou bien des collaborations conventionnellement établies
par territoire pertinent ou bassin de santé.
[1] Christian Bonal, MNASM
[2] Coordonnée par le Pr Thomas, CHRU de Lille
[3] Dr Gilles Vidon, Président de la CME du Centre Hospitalier Esquirol
[4] Comme le préconise, entre autres professionnels, le Pr. Frédéric Rouillon, CH Albert Chenevier, Créteil
[5] cf. l’étude de l’URML-IF de février 2000
suite
| Dernière mise à jour : jeudi 6 septembre 2001 17:11:34 Dr Jean-Michel Thurin |
| 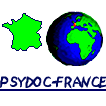
|