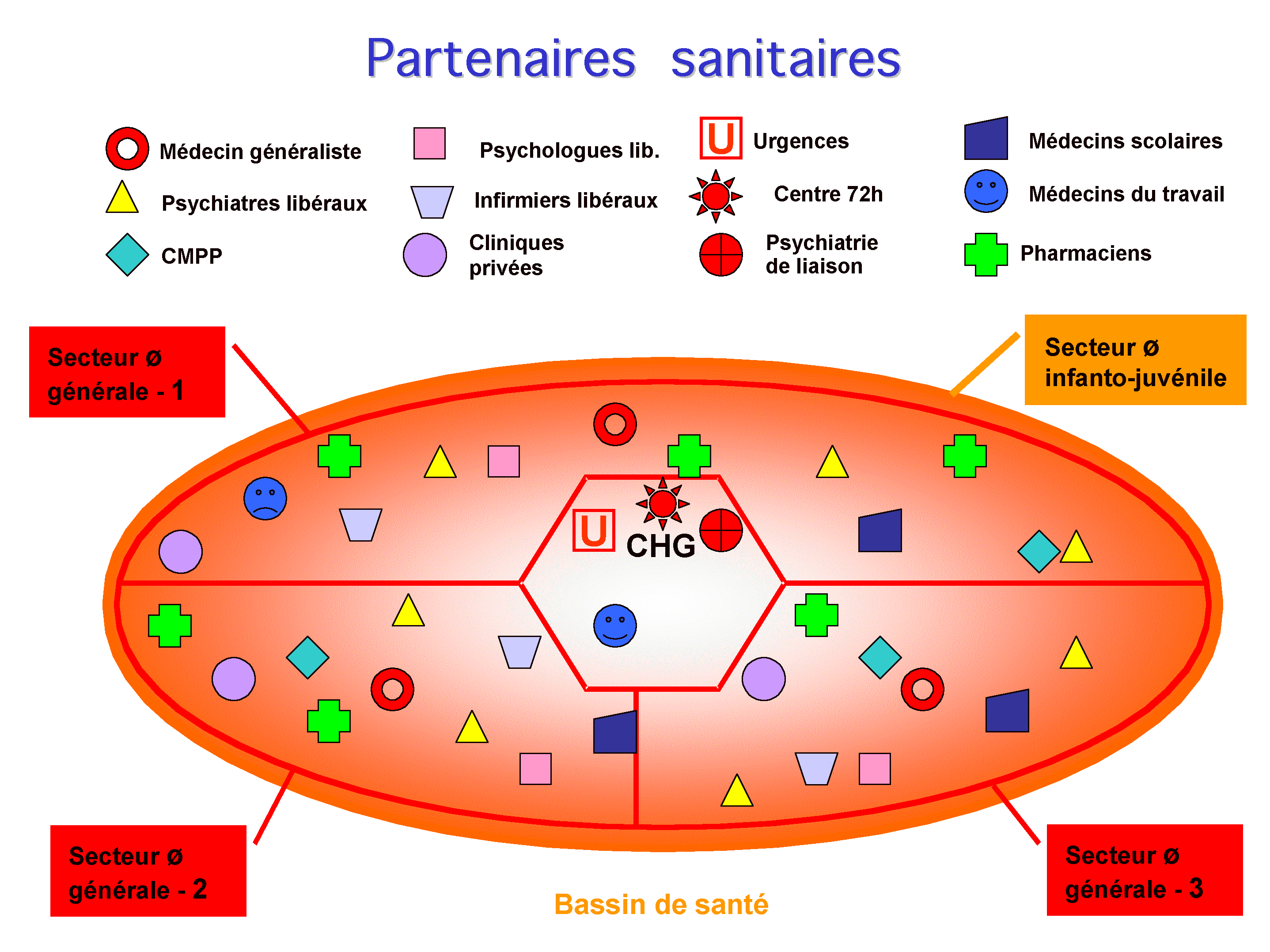
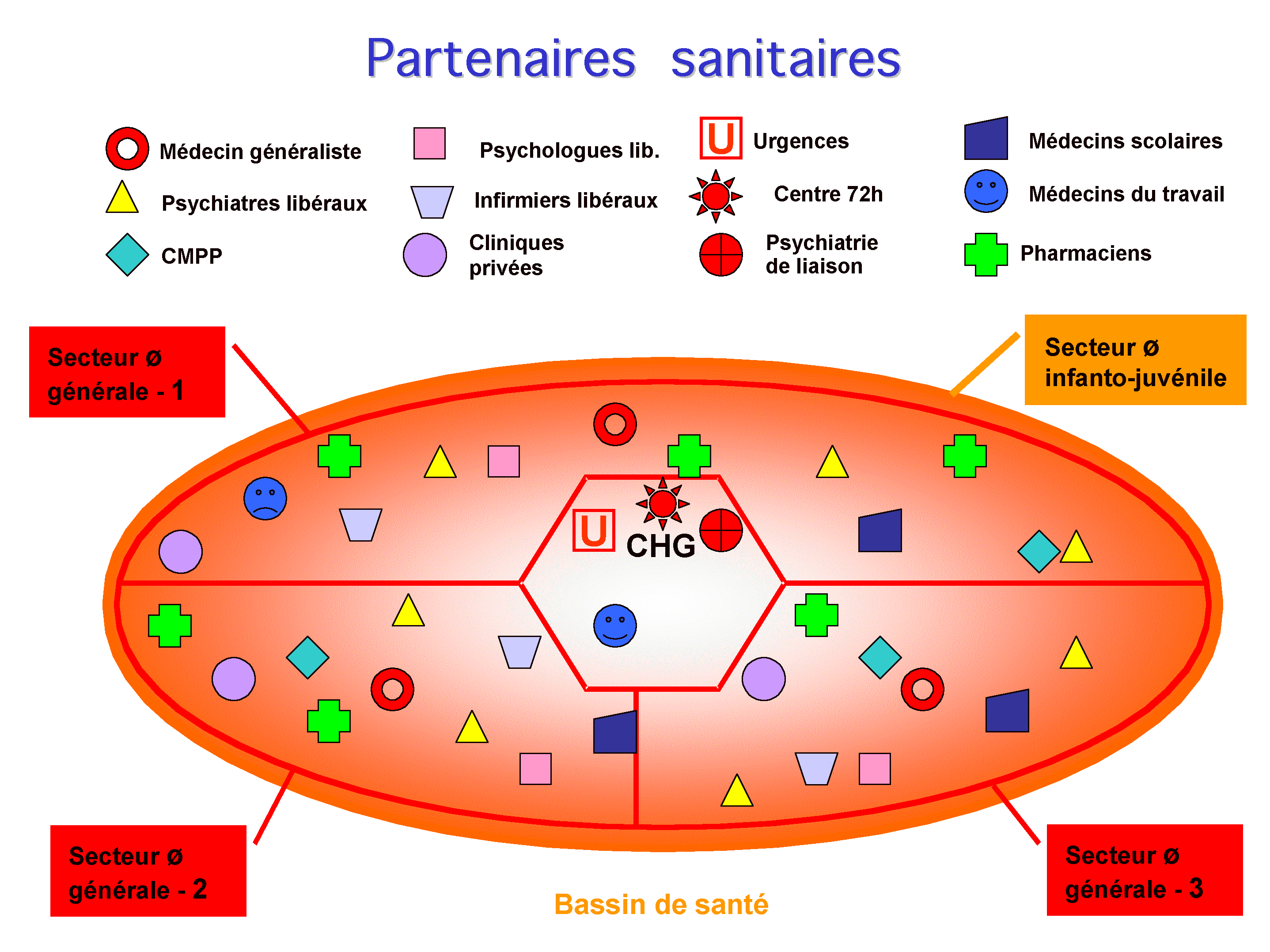
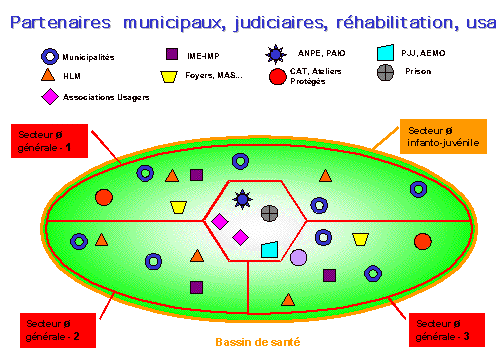
Cette nouvelle
répartition amènera un développement considérable
des soins dans la communauté.
Un moratoire sur les projets d’investissements lourds sur les sites des anciens CHS est indispensable dans cette nouvelle politique d’implantation des structures de soins.
Les investissement dans la restauration des locaux sur l’historique lieu asilaire ont le mérite de rendre propre ces locaux mais renforce le système concentrationnaire. Cette politique se fait au dépend des structures et activités thérapeutiques dans la communauté, dotées de moyens insuffisants par contre coup. Toutefois, il faut faire la différence entre les investissements concernant l’entretien nécessaire de locaux qui se dégradent et les investissements lourds pour rénovations importantes concernant des locaux destinés à des usagers pouvant être “ relogés ” dans des petites structures localisées dans la communauté. Dans ce derniers cas il paraît opportun de revoir les objectifs de ces investissements et de les attribuer à des projets dans la communauté pour les personnes qui sont actuellement dans les bâtiments intra-hospitaliers.
Les réinvestissements des sommes dégagées se feront directement dans les alternatives (“ l’humanisation par retour dans la communauté ”), dans les hospitalisations sur le secteur, dans le social. Cette domiciliation dans la communauté n’évoluera pas vers une ségrégation en psychiatrie aiguë et une psychiatrie chronique à la condition que tous les soignants (dans une programmation par territoire) prennent en charge les soins de ces personnes dans leurs nouveaux lieux de vie.
(Comme cela est
décrit plus haut)
Cette
planification est intimement liée à la protection des ressources
dégagées par la fermeture des lits de psychiatrie (tels
qu’actuellement). Tous les pays qui se sont engagés dans cette
voie l’ont fait en réorganisant les hôpitaux et en
transférant les moyens dans la communauté. Il faut que les
budgets suivent les usagers et soient utilisés à
développer le potentiel de
l’offre sanitaire, avec obligation en ce cas de dégager clairement
de nouvelles ressources affectées à des politiques ou des
programmes annuels. Ces options conditionnent la faisabilité de toute
politique.
Nous
sommes absolument opposés au remplacement des anciens
“ ghettos psychiatriques ” par les
“ nouveaux ghettos sociaux ” (créés par concentration des Maisons
d’accueil spécialisés à grande capacité,
Foyers à double tarification, foyers d’hébergement, longs
séjours, maisons de retraite spécialisées pour telle ou
telle population…) sur les sites des anciens asiles.
Si, pour de
nombreuses raisons, le social et le médico-social n’ont pas
jusqu’à maintenant ouvert leurs portes aussi largement aux usagers
de la santé mentale qu’aux autres personnes présentant un
handicap, cette situation doit impérativement changer. De plus des
structures communautaires expérimentales doivent être mises en
place pour ces personnes. Ceci éviterait l’effet lourdeur
institutionnelle. Les maisons communautaires doivent être ouvertes dans
les quartiers et les villes en liaison entre le social, le sanitaire et le
psychiatrique (par exemple, maison A. Breton à Faches-Thumesnil). La
continuité des soins devra y être assurée comme
actuellement cela se fait dans de nombreux appartements ou maisons
thérapeutiques. Il faut absolument donner un statut à ce type de
lieu de vie municipal articulant à la fois sanitaire et social.
Faut-il
rappeler qu’il y a bientôt 20 ans le rapport de notre
collègue Demay préconisait le
“ dépérissement ” des asiles ? Et que
Franco Basaglia, à Trieste, pensait l’arrêt des admissions
à l’asile comme une étape vers son
“ dépassement ”).
Toutefois,
cet arrêt programmé des admissions ne peut être
décidé, bien entendu, qu’après une (brève)
période de transition permettant la mise en place des petites structures
d’hospitalisation sur les secteurs.
Cette phase
pourrait être suivie d’une période suffisante pendant
laquelle les patients, toujours hospitalisés dans les anciennes
structures, bénéficieraient, à partir de projets de soins
individualisés, du temps nécessaire à la mise en
œuvre de ces projets dans l’indispensable partenariat avec les
secteurs sociaux et médico-sociaux.
Cette
évolution étalée dans le temps doit éviter tout
externement arbitraire et laisser le temps aux personnes et aux personnels
soignants de trouver les solutions les plus adaptées et de les mettre en
oeuvre. Il ne peut s’agir d’une sorte de psychiatrie à deux
vitesses mais de la prise en compte de l’histoire personnelle et
institutionnelle de ces personnes et de leur apporter les réponses
appropriées.
Au total il
s’agit d’offrir des prestations de qualité supérieure
au service remplacé, et non de reproduire la
“ ghettoïsation de l’hôpital
psychiatrique ” dans la cité (par exemple en créant
des unités d’hospitalisation de taille trop importante).
Le
projet de loi de modernisation du système de santé propose
quelques aménagements de la loi du 27 juin 1990 :
§
limitation des HO aux
cas d’atteinte "grave" à l’ordre public et
à un état nécessitant des soins ;
§
légalisation des
sorties accompagnées de courte durée (inférieures à
12 heures) ;
§
renforcement de la
composition de la Commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (un médecin généraliste et un
usager) ;
§
encadrement des
ordonnances de placement des mineurs en établissement psychiatrique
après avis médical pour 15 jours renouvelables sous conditions
précises.
Nous pensons qu’il faut aller plus loin qu’un toilettage
de la loi et envisager l’abrogation de la Loi de 1990 sur les soins sous contrainte. L’hospitalisation d’office et
l’hospitalisation à la demande d’un tiers seraient
supprimées. Une période d’observation et de soin de 72
heures serait instaurée, afin d’évaluer la
nécessité de soins.
Il ne s’agit pas
là de confondre traitement obligatoire[1], et obligation de soin, de même nous pensons que ces soins ne doivent
pas être réduits à une simple réponse
hospitalière.
L’obligation de
soigner s’applique
d’abord aux médecins, aux équipes de soin, à
l’Etat, dans le cadre du droit constitutionnel à la santé,
dans la dialectique entre la santé pour tous et le meilleur état
de santé pour chacun.
L'obligation de se
soigner s’adresse à une
personne, sujet et citoyen, dans sa parole et dans son vouloir. L'obligation de
se soigner est un moment dans les méandres de cette personne, qui laisse
pleine place à sa subjectivité, à son histoire, aux droits
et devoirs, à la négociation (sur les lieux, les
modalités, les engagements et obligations, ...). L'obligation de se
soigner est un parcours et une expérience partagés.
L’intervention
thérapeutique auprès d’une personne hors
d’état de donner son consentement est d’abord
nécessaire. Elle n’est obligatoire qu’en
référence à l’ “assistance à personne
en danger ”. Elle est éthiquement nécessaire et
légalement obligatoire. Certains estiment que
l’ “ événement social ” que
représente une obligation de soins nécessite une certaine
“ symbolisation ” ou un
“ témoignage ”, que la judiciarisation pourrait,
au moins en partie, faire.
Dans cette optique nous
nous replaçons également dans le droit commun (cela peut
concerner toutes sortes de personnes dans des circonstances diverses et pas
seulement les malades mentaux). Il n’y pas alors de réglementation
ou de loi spécifique à mettre en place.
Une loi
déspécifiée pour l’obligation de soin
s’impose. Le niveau
d’acceptation des soins devrait être apprécié par le
médecin au regard de son obligation de soigner et confirmée ou
non par le juge, au regard de l’application des lois et donc des droits
des citoyens.
La distinction entre
danger pour soi et autrui permettrait
de ne plus confondre l'obligation de soin et l’ordre public. Cette
modification de la loi s’inscrit
dans une évolution qui paraît inéluctable et qui aurait
l’avantage de resituer le système français dans le droit
européen.
Nous souhaitons une
vraie loi sanitaire laissant l’initiative aux médecins, dans le
cadre des pouvoirs décentralisés, sous la garantie effective et
de proximité, de la Justice.
En effet, le juge est le seul garant du respect des libertés
individuelles et du respect des procédures de l’obligation de soin
qui s’apparente tout de même à une perte de liberté
constitutionnellement du ressort du pouvoir judiciaire (juge au civil pour la
protection des majeurs et des mineurs).
Cette loi devrait
cependant veiller à son champ d’application et éviter sa
généralisation à des domaines jusque-là
préservés, à tout ce qui peut être jugé
“ comportement malade ” (un malade atteint du sida qui
refuse de se soigner, ou un malade qui refuse les transfusions sanguines par
conviction religieuse ou, pourquoi pas, un patient psychiatrique qui refuse un
traitement comportementaliste, psychothérapique ou
médicamenteux). Elle doit donner lieu à un balisage
sévère dans le conflit pouvant exister entre obligation de soin
et libertés individuelles.
Nous reprenons, ci-dessous, et faisons notre le cadre
de présentation et une partie des propositions présentées
par le bureau de la santé mentale de la DGS lors de nos
réunions de travail :
Cette
loi déspécifiée s’appliquerait à toute
personne dont les troubles nécessitent des soins immédiats et
constituent un danger sanitaire pour elle-même et/ou pour autrui et qui
refuse ou est empêchée de consentir à ces soins.
Le circuit de pris en charge serait alors le
suivant :
La personne est
transférée aux urgences de l’hôpital
général le plus proche.
La
question du transport des personnes
jusqu’à l’hôpital doit être envisagée. Il
devrait être de la responsabilité de l’établissement
hospitalier, siège des urgences, d’organiser, de coordonner avec
les différents services concernés (police, pompiers, Samu,
ambulances privées) le transport des personnes de l’origine de
l’appel jusqu’au service des urgences. Un certificat
détaillé et motivé d’un médecin demandant le
transport obligatoire, permet de ce fait l’intervention des services de
police si nécessaire, jusqu’aux urgences, est remis au directeur
de l'établissement Le certificat est adressé au Préfet et
au Maire si l'intervention des forces de l'ordre est nécessaire.
Le Centre
d’Accueil Intersectoriel (CAI)
situé à proximité immédiate du service des urgences
de l’hôpital général et la présence dans ce
centre, 24h/24, de membres des équipes des secteurs du bassin de
santé permet d’y accueillir toute personne
transférée.
Une
période d’observation et de soins de 72 heures (3 jours) maximum
commence alors. Cette période
permet, en situation de crise, d’instaurer un temps de recul comme
règle générale, et non comme exception, pour les
soignants comme pour le patient, avant de prendre une décision
d'obligation de soins ou non. Attendre un peu et voir, ne pas se
précipiter, prendre ensemble le temps d’évaluer tout en
commençant les divers formes de traitement (psychothérapie,
chimiothérapie…). Il ne s'agit en rien d'une "garde
à vue" psychiatrique mais bien de permettre la mise en acte de
soins véritablement adaptés à une personne dans une
situation donnée. Nous ne
sommes donc pas sur la ligne de la loi anglaise de 1983.
Doit être évoquée l’action d’une
“ personne de confiance ”, des associations
agréées d’usagers, d’un adjoint au médiateur
de la République chargé des affaires de santé mentale et, peut-être
aussi (à la suite des lois anglaise et écossaise), de la
création d’une commission indépendante de suivi de la loi.
Les CDHP (dont les compétences résultent notamment de
l’article L 332-3 du CSP) ne sont qu’un ersatz de commission
indépendante, aux pouvoirs d’investigation, de contrôle et
de décision modestes et dont la fréquence des interventions
(environ 2 fois par an) montre les limites.
Il est évident
que dans un tel système il
n’y a plus de place ni de justification pour l’Infirmerie Psychiatrique
de la Préfecture de Police à Paris.
Structure policière,
donc chargée du maintien de l’ordre, où travaillent des
psychiatres et dont il est difficile de trouver la justification de son
exception dans le paysage national, autrement que par son lien organique avec
cette même exception qu’est l’existence d’une
préfecture de police à Paris.
La décision d’admission est prise au service des
urgences de l’hôpital général par le directeur de
l’EPS, au vu d’un
premier certificat médical établi par un médecin non
psychiatre appartenant ou pas à l’EPS et d’un
deuxième certificat médical établi immédiatement par un
médecin spécialiste appartenant à l’EPS. Dans les
24h la décision est transmise au juge et, si nécessaire, au maire
et au préfet.
A l’issue
de cette période d’observation et de soin d’au maximum 72
heures, un troisième certificat médical pose l’indication
future :
§ sortie
(pas de traitement),
§ traitement libre (hospitalisation ou soins ambulatoires au choix de la personne)
§ obligation de soin si l’état de santé de la
personne nécessite des soins ou si elle ne peut donner son consentement.
Au fil de cette procédure, toute personne ayant
intérêt peut faire recours auprès du juge,
éventuellement assistée d’un avocat.
En cas d’obligation de soin, à l’issue des 72 heures, le troisième certificat
médical circonstancié pose l’indication de l'obligation de
soin, avec les avis souhaitables de la personne, de l’entourage ou
d’un travailleur social. La décision est transmise au juge qui
statue dans les 24heures et au préfet et au maire si nécessaire.
Pendant ces 24 heures, la personne est maintenue en hospitalisation.
Les obligations
de soin peuvent prendre deux modalités :
§
Soins
ambulatoires : si
l’état de la santé de santé de la personne
nécessite des soins susceptibles d’être apportés en
ambulatoire, la personne choisit avec le médecin les modalités
qui seront animées par d’autres soignants. La mesure est
révisée périodiquement et éventuellement
renouvelée après un mois.
§
Soins en
hospitalisation : si
l’état de santé de la personne nécessite un
traitement et une surveillance permanente et continue. La mesure est
révisée périodiquement et éventuellement
renouvelée au bout de 7 jours.
Ces deux modalités de l'obligation de soin
peuvent alterner. Ainsi, une personne
étant en obligation en hospitalisation et qui voit son état de
santé s’améliorer peut passer en ambulatoire ou voir une
levée de l’obligation de soins assortie d’un traitement
libre ou sans traitement. De même, une personne étant en
obligation de soins en ambulatoire et dont l’état de santé
s’aggrave, peut nécessiter des soins en hospitalisation. A
contrario, son état de santé s’améliorant, cette
personne verra la levée de l’obligation et la poursuite ou non
d’un traitement libre. Toutes ces mesures sont décidées
par le juge civil. Le maire et le préfet sont informés si
nécessaire.
Le schéma
suivant résume l’ensemble du circuit.
Pour les patients difficiles aux urgences, à
domicile, hospitalisés dans les secteurs, hospitalisés en
structures publiques ou privées non sectorisées, faut-il
encourager le développement des structures intersectorielles
fermées comme elles auraient commencé à se mettre en place
dans quelques hôpitaux (mais aucune évaluation n’est
à ce jour disponible) ? Nous n’y sommes pas favorables car une autre approche de ces patients, dans ces
moments-là, comme nous en avons vu des exemples notamment en France,
à Birmingham, en Italie et à Merzig en Allemagne, semblerait plus
productive.
Un certain nombre de secteurs en
France propose une hospitalisation sans service fermé. Ces secteurs
paraissent avoir privilégié le renforcement en personnels
soignants autour des patients plutôt que le renforcement des murs et des
clés. Ils affirment qu’il ne faut pas confondre obligation de
soins et enfermement. Dans ces
services, on considère généralement les personnes sous
contrainte comme en obligation de soin . Ce qui ne veut pas dire qu’il
n’y a pas de contrat de soins. Au contraire, quand les portes sont
ouvertes, le personnel doit être beaucoup plus présent. Cela
nécessite bien entendu “ des hommes à la place de
murs ”[2]..
[1] Hubert Mignot dans le Livre Blanc de la psychiatrie française de 1963 en signalait le caractère “ exorbitant ”
[2] Comme ne cesse de le dire le Dr Lucien. Bonnafé
suite
| Dernière mise à jour : jeudi 6 septembre 2001 17:11:27 Dr Jean-Michel Thurin |
| 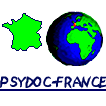
|